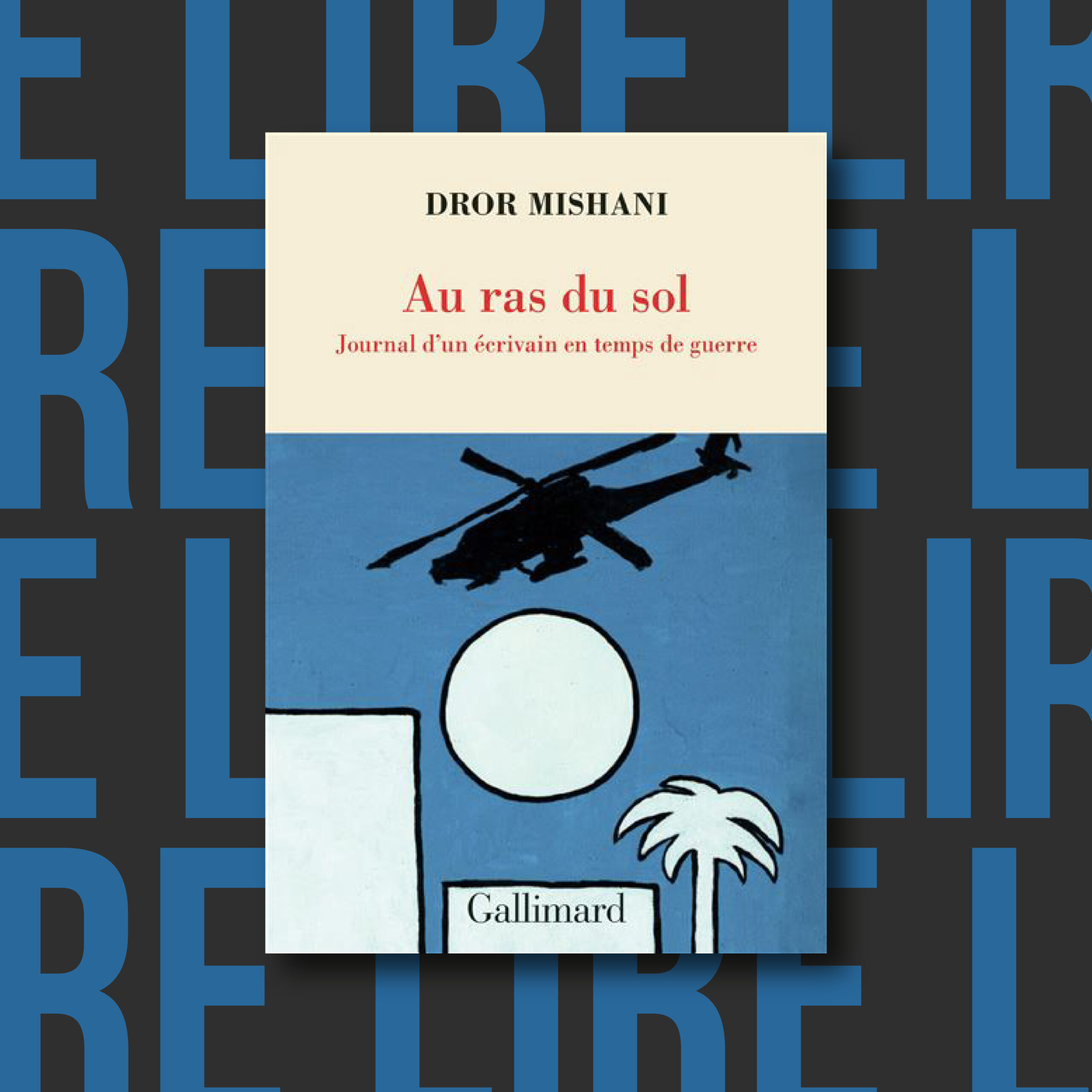Les carnets de Mira sont une série de témoignages proposés par Tenoua. Avec poésie, Mira Neshama Niculescu partage son quotidien dans un Israël en guerre et où le manque des otages se ressent partout. Pour retrouver tous les carnets de Mira, rendez-vous en bas de cet article.
On a tué Sinwar. Je l’écris et j’ai encore du mal à y croire.
Aujourd’hui, 17 octobre au soir. On sort tout juste du premier jour de Souccot. Tout juste dix jours après avoir marqué la funeste date du 7 octobre, et à une semaine d’une date que l’on redoute tous ici ; le premier Simhat Torah après le massacre. On a tué Sinwar.
Un an après le début de la guerre, les otages encore là‐bas, on a enfin trouvé, et tué, l’architecte du 7 octobre qui se cachait à Gaza depuis un an.
Et on l’a appris aujourd’hui, premier jour de la fête au terme de laquelle, l’année dernière, tout a commencé.
Premier Souccot après le 7 octobre
Aujourd’hui c’était le premier jour de Souccot.
Convocation sainte, Jérusalem vêtue de Souccot blanches et décorées, la prière sous les arbres au milieu des rues calmes, la Torah déployée au milieu des tallitot se balançant au rythme de la prière, l’etrog comme un soleil au coeur de la palme, du saule et de la myrte tressée, le Hallel (la louange) sur les lèvres et le cœur brisé.
Il y a un an, c’est le dernier jour de cette fête que l’on appelle “le temps de notre joie”, à l’aube du point culminant de la “joie de laTorah”, que l’attaque contre nous a été lancée.
101 otages, vivants ou morts, sont encore là bas. Maintenant sûrement dans les tunnels exclusivement, car ils ont vu que, dans des appartements, on a la capacité d’aller les chercher.
Quel défi d’entrer dans la fête de la joie alors qu’on est en deuil et en attente, et inquiets, pour tant d’entre nous, pour les fils et les maris qui sont envoyés au front, à Gaza ou au Sud Liban.
Et pourtant le ciel est glorieux, les grenades succulentes, l’air bon après les grandes chaleurs de l’été, la lumière sur les pins brille sans brûler.
Ce sont nos cœurs qui sont brûlés, et nos systèmes nerveux.
L’année dernière, l’attaque du 7 octobre a eu lieu le jour de Simhat Torah, “la joie de la Torah”. Comment ne pas y penser ?
Aujourd’hui je pensais à Sinwar et je me disais : il faut qu’on l’attrappe, pour que quelque chose change. Il faut qu’on l’attrappe.
Mais comment va t on l’attraper ? Cela semblait impossible.
Je priais, sans même oser y croire.
Ces dernières semaines, on avait réussi, par des frappes chirurgicales remarquables, à avoir les grands leaders des organisations qui s’employaient à éliminer Israël et tous ses habitants depuis des décennies.
Aujourd’hui la nouvelle a été confirmée : hier, à Rafah, la ville que les foules occidentales pleines de bonnes intentions nous demandent depuis des mois de “ne pas toucher”, on a tué Sinwar, qui se cachait, sans surprise, dans la zone la plus densément peuplée de civils gazaouis réfugiés.
J’ai eu la nouvelle avant de rallumer mon téléphone.
Comme pour la libération de Noa. Comme pour la liquidation de Nasrallah.
Pour Noa j’étais à Paris. C’était shabbat. J’avais retrouvé une amie sur l’un des gazons de la place des Vosges. Au moment où on s’est levées pour partir, elle m’a dit “oh je ne t’ai pas dit : ils ont libéré Noa Argamani!”
Je lui suis tombé dans les bras. J’ai pleuré. Noa. Quel symbole du 7 octobre, son beau visage pur éploré, les mains tendues vers son homme en sang retenu par deux terroristes, lui les mains derrière le dos, et elle enlevée entre deux sur une moto, qui tendait ses bras encore libres vers lui en criant de toutes ses forces.
Noa avait été sauvée, et je l’ai appris un shabbat.
J’avais pleuré de joie.
Pour ceux que l’on tue, point de joie à proprement parler, mais un soulagement. Un sentiment de justice qui se fait. De rapport de force qui s’inverse, triste réalité de la guerre.
Nasrallah, le chef du Hezbollah qui, sans l’excuse du Hamas de résistance à “l’occupation”, avait dédié sa carrière à détruire Israël, c’est le vendredi soir du shabbat avant Rosh haShana que j’ai appris qu’on l’aurait éliminé.
C’était le voisin de Philippe et Sophie, chez qui je dînais, qui venait de leur dire. Je venais de rentrer en Israël quelques heures auparavant.
La nouvelle a été confirmée en fin de journée, le lendemain, shabbat.
Comme quoi même chez les “religieux”, la nouvelle circule. Il y en a toujours autour de nous qui regardent leur téléphone, et qui s’empressent, dans la rue, dans des croisements amicaux ou des conversations de voisinage, de faire circuler la nouvelle.
On se coupe du monde pour un jour et soudain, on apprend que quelque chose de radical a avancé. Car pour nos soldats, point de pause. Pikuah Nefesh, la nécessité de sauver des vies, prime sur le shabbat.
Pour Sinwar, j’ai aussi appris la nouvelle dans la rue, dans la nuit étoilée du temps sacré, avant de me reconnecter au monde extérieur.
La bonne nouvelle qui ne réjouit pas
Ce soir, en rentrant après les trois premières étoiles dans les rues calmes illuminées de souccot sages, j’ai croisé devant un immeuble, juste avant de tourner dans ma rue, un habitant américain au grand sourire. Il était en train de souhaiter “bon festival” (moadim l’simha) à son voisin tout en supervisant du regard sa petite famille en train de remonter dans la voiture après le premier jour de fête, et il a ajouté, gaillard : “oh did you hear? We got Sinwar!”
Je venais de les dépasser. Je me retourne d’un bond :
“- Pardon, quoi? Êtes-vous sûr?
- On dirait. On attend confirmation, mais a priori on l’a tué.”
J’ai tenté de rester calme. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs.
“De faux espoirs.”
Oui cela me rend triste d’écrire cela. J’avais peur d’avoir un faux espoir à la nouvelle qu’un être humain ait été tué.
Car c’était un espoir. Et oui, c’était un être humain.
“Mais ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux”, me direz‐vous peut‐être.
J’entends ce type de discours depuis le début de la guerre. Et je le comprends.
Je comprends une terminologie qui exprime le choc devant les manières “inhumaines” d’avoir massacré le 7 octobre et de traiter les otages depuis.
Mais l’argument que, lorsque les humains se conduisent de manière monstrueuse, ils deviennent “des animaux” tout d’abord est incorrect, et puis il est dangereux.
Il est incorrect car les animaux n’ont pas la perversité dont seul l’humain est capable.
Par contre, ces manières “inhumaines” d’agir„ en termes d’idéal moral, sont malheureusement, phénoménologiquement, profondément “humaines”.
Et aucun d’entre nous n’est immunisé contre la sauvagerie dont on est tous capables, avec assez le lavage de cerveau et de pression sociale. Regardez ce que la Chine communiste a réussi à faire faire à ses jeunes. Les nazis à ses soldats. Tout semble incroyable hors contexte. Mais l’humain bascule dans l’inhumanité plus vite et plus facilement qu’on ne le croit.
Alors justement, déshumaniser l’ennemi, de notre côté, me semble jouer le jeu dangereux de ceux que l’on critique.
C’est ainsi que la Shoah est arrivée.
Parce qu’on a répété aux gens assez longtemps que les Juifs n’étaient pas humains, les gens ont fini par le croire. Et par les traiter ainsi.
Sinwar était humain. Hitler aussi.
Et tous les autres monstres de notre humanité.
Alors non, je ne me réjouirai pas que l’on ait dû tuer encore un humain, fait, n’en déplaise à notre indignation, à l’image de Dieu.
C’est d’ailleurs de là que vient l’injonction de Mishlei (24,17)
בִּנְפֹ֣ל (אויביך) [א֭וֹיִבְךָ] אַל־תִּשְׂמָ֑ח וּ֝בִכָּשְׁל֗וֹ אַל־יָגֵ֥ל לִבֶּֽךָ׃
Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas; s’il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas.
פֶּן־יִרְאֶ֣ה יְ֭הֹוָה וְרַ֣ע בְּעֵינָ֑יו
Sinon Dieu le verra et ce sera mal à ses yeux
Que fait‐on de nos textes lorsqu’ils nous mettent en garde contre la tentation de faire à l’autre ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse ?
J’ai encore en tête des vidéos de rues de Gaza le 11 septembre 2001.
C’était la liesse dans la rue. Les gens faisaient la fête.
Tout comme le 7 octobre, partout, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie, et ailleurs, on chantait, on se gargarisait de la meurtrissure de l’ennemi occidental et de son symbole à détruire, la puissance américaine dont Israël représente, à leurs yeux, un avant‐poste à brûler. Les bonbons aux enfants, Dieu est grand, on brûle les drapeaux, et s’il y en a, on crache sur les cadavres paradés devant la foule en liesse.
Ce n’est qu’un exemple extrême de ce contre quoi nos textes nous mettent en garde.
Oui c’est un sale boulot que de devoir éliminer des monstres.
Ce sont de bonnes nouvelles.
Mais que l’on ne s’en réjouisse pas.
Architecte de la terreur
Je me suis hâtée vers la maison avec un début de sanglot.
J’ai attendu d’avoir confirmation qu’il avait été vraiment tué afin de me laisser aller à pleurer. J’ai sangloté un moment.
Comme lorsqu’un cauchemar prend fin, et qu’enfin la tristesse peut sortir.
Le soulagement, aussi.
Soudain, on entrevoit que quelque chose va pouvoir bouger dans la dynamique sordide de la prise d’otage d’Israël – car c’est bien le pays entier qui a été pris en otage.
Ces derniers mois, quelque chose commençait à se passer. On avait réussi à éliminer les grands chefs des mouvements qui travaillaient à notre perte. Deif, Nasrallah, et d’autres.
Lui continuait à nous échapper.
L’architecte de ce massacre, comme les journaux l’appellent, a fait comme ses prédécesseurs : comme Hitler lorsque le vent a tourné, comme Saddam Hussein, Ben Laden, ou Nasrallah, il se cachait sous terre.
Lâcheté des vrais monstres.
On l’a cherché pendant un an.
Imprenable, implacable, il continuait.
Je pensais à ceux qui ont essayé d’éliminer Hitler avant qu’il ne continue son ravage, et y ont perdu leur vie.
Hitler a fini par prendre la sienne avant qu’on ne l’attrape.
Et je crois que ce qui se passe aujourd’hui, dans l’acharnement des foules occidentales pleines de bons sentiments, à définir l’État juif – qui, de facto, se défend dans une guerre d’agression acharnée de tous côtés – en agresseur tout puissant en pleine velléité d’expansion colonialiste dans tout le Moyen‐Orient (“Ils s’en prennent au Liban, maintenant”, entend‐on dire par les Français indignés. Et vous verrez, bientôt ce sera la Syrie et l’Arabie Saoudite.”). Oui cette inversion des rôles appuyée sur une cécité remarquable aux fait, n’est pas étranger à ce moment‐là : la défaite d’Hitler a marqué un changement de paradigme dans les mentalités occidentales.
Du jour au lendemain, les Occidentaux, hier colonisateurs triomphants de l’Inde et de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Océanie, ont changé leur fusil d’épaule.
Jusqu’à l’heure de la défaite nazi, il était bien vu d’être dominant, et être opprimé était méprisable. On était responsable d’être faible. Le Juif de diaspora était alors coupable d’être faible.
Mais depuis la chute d’Hitler et la montée d’Edward Saïd, pour l’Occidental pétri, dans son inconscient collectif, d’une culpabilité post‐coloniale que, par définition, il ignore, le nouveau héros, c’est l’opprimé.
It has become cool to be the underdog.
Alors le Juif d’Israël reconstruit, surtout depuis qu’il a commencé à se défendre et à gagner des guerres, est devenu coupable.
Le bouc émissaire continue de jouer parfaitement son rôle. Il porte maintenant sur son front les projections occidentales de “puissance colonialiste impérialiste”, tandis que l’étiquette glorieuse de “peuple indigène” et de “résistance décolonisatrice”, dans un retournement de situation qui relève de la folie collective, est gracieusement, au mépris des faits, apposée au Hamas comme une couronne de saint.
Et Hamas a su en jouer.
La victimisation est l’autre face de sa monnaie de la terreur, un dispositif que Caroline Fourest a pu analyser ailleurs, dans le cas des Frères Musulmans.
Mais s’ils jouent la victime vis‐à‐vis de l’opinion internationale, les milices islamistes radicales ont choisi la terreur comme modalité de guerre.
Et dans cet art, Sinwar était passé maître.
Nous avions une longue histoire avec lui.
Terroriste de longue date, arrêté après plusieurs attaques et meurtres, celui que ses pairs avaient surnommé le “boucher de Khan Yunis” avait passé vingt‐deux ans dans les prisons israéliennes. Il y aurait passé sa vie s’il n’y avait eu Gilad.
Il y avait été soigné d’un cancer. Tumeur au cerveau. Y avait fait des études.
Payées par les impôts des citoyens israéliens, comme celle qui écrit ces lignes, et qu’il a dédié sa vie à rayer de la surface de la planète.
Il avait appris l’hébreu ; eu le temps de traduire en arabe les textes juifs. Il nous a étudiés.
Il a compris nos faiblesses, la sacralité que l’on accorde à la vie humaine, un ethos aux antipodes des mouvements islamistes fondamentalistes où règne la culture du shahid (martyre), et où les jeunes sont élevés pour devenir kamikazes, les corps humains comme première arme de leur arsenal de guerre.
Et nous, de l’autre côté…“Qui sauve une vie sauve un monde” (Sanhédrin 4,5), nous enseigne le Talmud nous rendant de ce fait, en quelque sorte, vulnérables à la terreur.
Face aux prises d’otages, on est sans défense, car on fera tout pour récupérer les nôtres.
En 2011, au terme d’une très longue négociation, Gilad Shalit, un jeune soldat franco‐israélien retenu otage du Hamas pendant plus de cinq ans à Gaza, avait été échangé contre des prisonniers. 1027. L’un d’eux était Yahia Sinwar.
Aujourd’hui, la photo en gros plan du cadavre de Sinwar passe en boucle sur les réseaux, et des chants d’allégresse éclatent au loin, dont je ne sais distinguer si c’est pour le premier soir de Souccot, ou pour l’élimination de Sinwar.
Jérusalem en joie ?
La nuit de Jérusalem dans laquelle j’écris ces lignes a trois sons.
Son silence, d’abord, si guérisseur, la nuit noire piquée de minuscules étoiles, la lune pleine qui l’illumine en ce premier soir de Souccot.
Ses chants, ensuite, de loin en loin, entre hauts‐parleurs et klaxons joyeux, dont je ne sais s’ils célèbrent la fête ou la mort de l’ennemi.
Ses ambulances, enfin, de loin en loin, qui me font frémir à chaque fois, car j’ai peur que ce soit une hazaka(alarme lorsque des missiles arrivent), ou qu’il soit arrivé malheur.
Oui je veux rester loin des chants de célébration.
Ne voit‐ on pas ?
J’ai encore en tête les images entrevues de Gaza, kikar Palestine, le 7 octobre en liesse, les klaxons, les chants de joies, allah u akbar, Dieu est grand, hitba’h el yehoud, “tue le Juif”.
La foule qui se se bouscule autour des pick‐ups victorieux du Hamas – ou des voitures conduites par des civils gazaouis, dont certaines volées à des Israéliens, devenues chars de parade de civils de tous âges pris en otage, hébétés et attachés, battus, ensanglantés, parfois déjà violés, déjà morts pour certains, la foule ivre de son propre sentiment de puissance, voulant y mettre la main aussi au point que même les ravisseurs devaient protéger les captifs pour empêcher la foule de les lyncher de joie.
Et l’Occident, qui a vu ces images, traite Israël de génocidaire, et cela, de résistance.
Dans nos rues, Dieu merci, on n’a jamais vu cela.
Il y en a toujours, bien sûr, pour se réjouir et vouloir chanter et danser de la mort de l’ennemi. Mais le mouvement général est une forme de sobriété dans la victoire.
On ne se réjouit pas de tuer un ennemi. C’est le sale boulot qu’il faut bien faire.
J’ai souvent en tête cette phrase célèbre attribuée à Golda Meir
“Quand la paix viendra, nous pourrons peut-être pardonner aux Arabes d’avoir tué nos fils. Mais il nous sera plus difficile de leur pardonner de nous avoir forcés à tuer leurs fils.
La paix viendra quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu’ils ne nous détesteront.”
C’était en 1973. Rien n’a changé.
Tant que Sinwar et les siens choisissent cette stratégie au carré d’utiliser leurs enfants comme boucliers humains afin, dans un premier temps, de mieux mettre l’armée israélienne dans un double-bind de combat impossible, et dans un second temps, pour mieux ensuite aller pleurer au génocide devant la commuanuté internationale, on reste bloqué dans un cycle pervers de la violence.
L’un des petits pas que l’on peut faire est de ne pas se réjouir de la mort de l’ennemi.
Bien sûr, aucun rapport avec les liesses collectives dans les rues de Gaza.
Mais si nous nous laissons aller à l’allégresse aujourd’hui dans nos coeurs, le mouvement, en son centre, est le même :
Pourquoi Mishlei nous enjoignait‐il de résister à la tentation de se réjouir de la défaite de l’ennemi ? Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas.
Pas seulement parce que cela déplairait à Dieu, qui nous en voudrait, car l’ennemi est d’abord un homme, fait à l’image de dieu, comme nous.
Oui, même Hitler. Oui, même Sinwar. Quoi qu’ils soient devenus et qu’ils aient fait de cette image divine, qu’ils ont choisi de piétiner, en eux d’abord.
Pas seulement parce que ce serait stratégiquement naïf de se réjouir. On ne fait que gagner un peu de temps. Sinwar tombé devient une icône en face. Un autre prendra la relève. Ça ne résout pas le problème.
Mais aussi parce qu’il en va, plus prosaïquement, d’un pragmatisme qui nous sauvera peut‐être, à terme, de la violence de l’homme sur l’homme. Et cette éthique prosaïque, c’est le cœur de la Torah.
L’éthique prosaïque de la Torah
Bien avant l’humanisme individualiste des Lumières d’un Tocqueville ou d’un Rousseau, le Talmud nous l’enseignait à travers la bouche de Hillell (Shabbat 31a):
“Ce qui t’es détestable, ne le fais pas à autrui.”
Dans quel contexte Hillel dit‐il cela ?
En réponse à un goy, un non‐Juif venu le défier de résumer toute la Torah “sur un pied”, c’est‐à‐dire en un temps très court.
Et voici comment Hillel résume l’éthique biblique, et l’ethos juif.
Rabbi Akiva fera un pas plus loin en nous enjoignant d’“aimer notre prochain comme nous‐mêmes.”
Mais avant cela, au moins cela : le degré minimum de l’éthique.
Ne pas faire ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse.
Nous avons détesté voir nos morts profanés.
Alors pourquoi les médias israéliens montrent‐ils ce soir en boucle de multiples photos, parfois en gros plan, du visage gris de Sinwar mort sous les décombres ?
Je comprends l’effet cathartique.
Bien sûr je le comprends.
Peut‐être même que nos médias veulent ce soir donner à chacun d’entre nous une forme de satisfaction de voir, enfin, voir, de nos yeux, le monstre abattu.
Mais se réjouir ?
La mort du monstre nous a‑t ‑elle ramené Naama ?
Et Omer ? Et Kfir, et ses parents et son frère ? Et tous les autres ?
D’un point de vue militaire, stratégique et, il faut le dire, moral, en cette date hautement symbolique du premier jour de Souccot, la mort de Sinwar apparaît presque comme un miracle.
Un soulagement immense.
Un sentiment de justice faite.
Et surtout, un début d’espoir. On savait qu’avec lui au leadership, aucun nouvel accord de libération des otages ne serait fait.
Sinwar défait après que les autres leaders du Hamas aient été démantelés un à un, qui à Gaza, qui au Liban, qui en Iran, cette nouvelle victoire marque un tournant dans cette guerre sordide.
Le forum des familles des otages, qui vient de publier une déclaration en réponse à la nouvelle, nous le rappelle : c’est cela qui compte, et ce tournant est fragile.
Il pourrait même, dans la panique provoquée chez Hamas, mettre la vie des otages en danger, si on n’agit pas avec beaucoup de finesse, tout de suite.
Soudain, en ce temps de guerre et de fête, le bel ordonnancement du temps par Kohelet (l’Ecclésiaste) devient contrarié, et les pistes brouillées.
Kohelet contrarié
À Souccot, ce temps de transition, de soulagement et de réjouissance, on lit Kohelet. La sagesse attribuée au roi Salomon (chap 3) nous rappelle l’importance de séparer les choses :
Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel.
Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était planté;
Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir;
Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser.
Or aujourd’hui, au cœur de la réjouissance prescrite de la fête de Souccot, le temps n’est pas seulement au soulagement, désormais militaire en même temps que rituel, mais aussi, toujours, à la peine, et à l’inquiétude.
Ce n’est pas le temps de se reposer. C’est le temps d’avancer dans la stratégie pour récupérer les otages.
Lors de leurs premières déclarations officielles, ce soir, Gallant et Bibi ont dit la même chose : ce qui compte, c’est que l’élimination de Sinwar représente un pas de plus vers le retour des otages israéliens.
Bibi, que je suis loin de porter dans mon cœur, s’est adressé ce soir aux combattants du Hamas avec ces mots dont je prie qu’ils seront entendus :
Quiconque nous ramène les otages aura la vie sauve.
Quiconque leur fait du mal a son propre sang sur sa tête.
Oui ce soir, un an après le 7 octobre, en ce premier jour de Souccot, les cartes sont rebattues, d’une manière plus radicale que tous les autres pas accomplis depuis un an.
C’est une victoire immense.
Je remercie Dieu. Je ressens une fierté et une gratitude immenses pour Tsahal.
Mais je ne me réjouis pas de la mort de l’ennemi.
Au contraire, pourrons‐nous avoir le courage de nous en montrer dignes ?
Notre tradition nous interdit de regarder un cadavre.
Par respect pour le défunt.
Nous respectons‐nous, nous‐mêmes, lorsque nous ne montrons pas d’égard pour l’humanité de l’ennemi ? Même le pire ?
Le gros plan du cadavre de Sinwar sera peut‐être retiré des réseaux demain. Mais je redoute déjà l’inondation, sur les réseaux sociaux, de pamphlets, caricatures, mots d’esprits et blagues macabres, par des petits malins qui n’ont pas risqué leur vie pour tuer le défunt leader du Hamas mais qui, en revanche, vont céder à la tentation de s’en vanter, parlant de ce fait le même langage que nos ennemis.
N’ont‐ils pas compris, ceux qui se réjouissent aujourd’hui, que dans ce jeu macabre, ceux qui dansent aujourd’hui, pleureront demain ?
Cette année, premier Souccot après le 7 octobre, alors que nous sommes toujours en guerre, le monde ordonné par Kohelet semble être retourné au tohu-bohu (chaos) primordial.
Soudain les temps sont confondus, et l’on est obligés de vivre dans les contrastes :
La joie prescrite à Souccot et le cœur lourd de la guerre.
Le soulagement procuré par l’élimination d’un ennemi, et la tristesse de devoir faire le sale boulot
La fierté pour nos soldats, et l’inquiétude pour nos proches au front.
L’espoir réveillé par cette victoire, et le pessimisme quant à la situation géopolitique à long terme.
Oui pour ce Souccot en temps de guerre, le temps comprimé mélange les extrêmes :
Le temps pour rire est aussi un temps pour pleurer,
Le temps pour danser est aussi un temps pour se lamenter,
Le temps pour tuer est aussi un temps pour guérir.
On est obligés de vivre ces registres en même temps.
Dans ma synagogue, il a été décidé qu’on ne dansera pas, cette année, à Simhat Torah.
Dans la souffrance comme dans la victoire, c’est le temps de la dignité.
Quant à se réjouir pour de bon, je chanterai quand mes frères et soeurs seront revenus de captivité.
Retrouvez les autres carnets de Mira :
- Debout par terre
- Ma lumière
- Le ciel sans Hersh
- 9 mois depuis le 7 octobre, la pire des gestations
- Yom haAtsmaout après le 7 octobre: "Zionism is beautiful"
- Yom haZikaron après le 7 octobre: apprendre d'eux
- Pessah en guerre, une poésie du nous
- 6 mois de guerre: la nouvelle solitude d'Israël
- 100 jours, le carnet des otages
- Troisième carnet de guerre
- Deuxième carnet de guerre
- Carnet d'une semaine de guerre