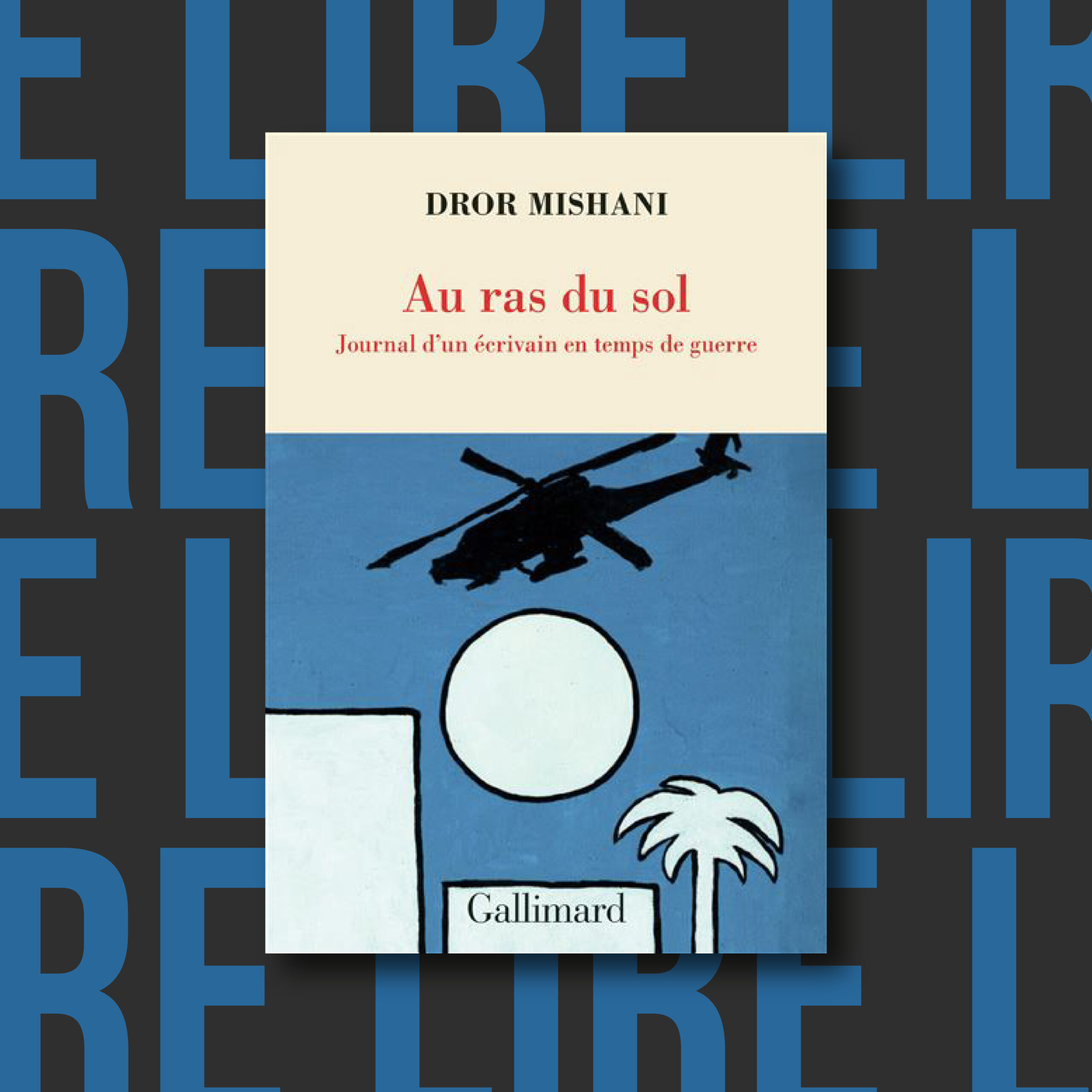Traces
Carnet d’une française en Israël
Ce troisième volet du carnet de guerre prend la suite du Premier carnet: La guerre de Simhat Torah et du Deuxième carnet: Les jours d'après. Il déroule les ressentis et les instants de guerre d’une Telavivienne d’aujourd’hui, moderne et religieuse, une intellectuelle ordonnée rabbin, une enseignante de méditation, une artiste et une contributrice régulière de Tenou’a. Afin de faciliter la lecture de ce carnet chapitré, vous trouverez ci‐dessous des liens vous permettant de circuler dans le texte.
1. Le ciel qui pleure
2. Bucolique
3. Notre vie, c’est des fraises
4. La trace
5. Le trou
6. L’absence
7. Le sang
8. Somatisation
9. L’empreinte
10. Le retour
11. Sous les regards
12. La mémoire
13. Les enfants parlent
14. Le rêve d’Alma
“Nulle chose n’existe qui ne laisse de traces”
Jeroen Brouwers. Rouge Décanté, incipit. Paris, Gallimard, 1981.
Dimanche 19 novembre.
Soudain, l’hiver est venu.
C’est arrivé d’un coup, ou presque.
Un matin, j’ai eu un peu froid.
J’ai mis un pull en coton, la première couche sur la peau depuis de longs mois.
Et puis il y a eu, un ou deux matins, quelques instants d’une pluie douce. Comme si elle s’était égarée en chemin et qu’elle n’était pas sûre d’être au bon endroit.
De l’eau du ciel, on en n’avait pas vu depuis juin – ou juste une fois, une courte averse prometteuse, pendant Souccot.
À Souccot, traditionnellement, les Juifs prient pour la pluie.
On prie car ce sont elles, les rudes averses du court hiver israélien, qui vont nourrir la terre pendant presque dix mois d’un été implacable. On prie pour qu’elle vienne, l’eau du ciel, et qu’elle vienne en douceur si possible.
Les pluies douces, en Israël, sont les meilleures. Elles pénètrent la terre en profondeur plutôt que de la faire débouler.
On les appelle gishmei brakha, les “pluies de bénédiction”.
C’est pour elles que l’on prie. Mais souvent, ce sont les autres que l’on reçoit : les gros nuages qui éclatent comme un déluge.
Ces premières pluies de début novembre, quatre semaines après le massacre du 7 octobre, prennent un autre sens.
Le ciel qui pleure
Le bruit doux de l’eau sur les vitres, les traînées d’eau soudain, dont on avait presque oublié la possibilité, coulent comme des larmes douces.
Elles se mêlent au sang versé sur la terre.
Ces premières pluies, comme des larmes silencieuses, apportent enfin un peu de soulagement.
Après le choc, beaucoup d’entre nous avaient les yeux désespérément secs.
Pour certains cela a duré quelques jours.
D’autres n’ont pu commencer à pleurer qu’après des semaines.
Je me souviens, juste une semaine après, ce soulagement de la pluie qui pleurait avec nous.
Par contraste avec les cris hargneux des humains dans les manifestations pro‐palestiniennes dans le monde entier, la dignité du ciel qui pleure avec nous en silence, la douceur soudaine que seules les larmes peuvent procurer au cœur crevé.
On a même vu un arc‐en‐ciel.
Un arc tout entier dans le ciel gris de Tel Aviv. Il s’étendait d’un bout d’horizon à l’autre. L’incroyable beauté de ces bandes de couleurs fluorescentes, un clin d’oeil d’espoir ?
D’après la Torah, l’arc-en-ciel est une promesse.
Après le déluge, Dieu envoie un arc‐en‐ciel comme la promesse d’un nouveau pacte entre le Divinet l’humanité :
les hommes pourront se détruire comme ils le veulent (le fameux hamas, corruption et fureur mentionné au début de la parashat Noa’h, qui selon le verset, pousse Dieuà causer le déluge pour effacer l’Hommede la surface de la terre), le créateur ne détruira plus son oeuvreC’est l’existentialisme biblique dont parle Levinas : Dieu a fait l’humain absolument libre‑y compris de s’entre-détruire. Et pour le rendre absolument libre Dieu l’a fait libre y compris de le renier. Dieu a pris le risque de l’athéisme. L’Arc en Ciel est le signe de cette promesse, et peut‐être aussi, une consolation.
Le début de l’hiver, chez nous, cela veut dire deux choses : il y a des choses qui partent, et des choses que l’on rajoute.
J’ai remis des chaussettes, pour la première fois depuis des mois.
Le chien perd ses poils à n’en plus finir. On les ramasse par touffes blanches entières, sur le sol, ou à même son pelage mordoré.
Il peut maintenant s’allonger à nouveau paresseusement au soleil du balcon, car le soleil ne brûle plus.
Des choses que l’on quitte, des choses qui se détachent, des choses que l’on ajoute. N’est-ce pas la définition du changement ?
Même le visage de la guerre change, à mesure que les identifications des corps avancent, à mesure que les bombardements s’intensifient, que l’opinion publique se déchaîne, à mesure que l’on en apprend davantage sur les sévices sexuels subis par les femmes, à mesure que le sort des otages, après un long, très long, supplice de statu quo, se dégèle un peu.
Et voilà qu’aujourd’hui enfin, après ses timides débuts, l’hiver s’est déclaré.
Il a éclaté dans un gros nuage de pluie qui se fend comme un cœur crevé.
C’était une forme de soulagement, après des semaines où l’on était paralysés par la douleur, le choc de ce qu’on venait de subir, et de la manière dont le monde s’en réjouissait ouvertement‐– le traumatisme au carré.
Le ciel, enfin, n’en finit pas de pleurer, les vitres qui ruissellent, le drapeau israélien sur notre balcon, trempé jusqu’à sa moelle de tissu malmenée par le vent.
Les trombes d’eau tombent comme le ciel sur la tête.
Les rues s’inondent, tellement on n’est pas équipés pour la pluie. Notre immeuble aussi. Chez nous, lorsqu’il pleut, la pluie entre par les interstices des fenêtres, à travers le mur.
C’est mal isolé, et pourquoi s’embêterait-on pour une dizaine de jours de pluie par an ?
Le pogrom de Simhat Torah était il y a quarante jours. On est passé de l’été à l’hiver, et la guerre s’enlise. On pense à eux là‐bas, dans les tanks, et dans les camps, dans la boue.
La pluie lave un peu les cœurs, la poussière des vitres et celle du trottoir. Elle diluera peut‐être un peu du sang que les volontaires de Zaka n’auront pas réussi à effacer sur les trottoirs devant les maisons et sur les murs. Mais elle n’est pas magique. Elle n’efface pas les traces.
Aujourd’hui, alors que la guerre bat son plein, celles‐ci commencent à se donner à voir.Aujourd’hui c’est le premier dimanche du mois de Kislev : le mois qui verra naître Hanoucca, la fête du miracle, la fête de la victoire des lumières sur l’obscurité.
Verra‐t‐on un miracle, en Israël ?
Cinquième semaine de guerre.
L’hiver vient de faire irruption au Moyen‐Orient, et ici, c’est la saison des fraises.

Bucolique
Vendredi dernier, je suis allée cueillir des fraises.
Ça peut paraître bucolique, et ça l’est dans le titre. J’aimais me dire à moi‐même, comme une chansonnette “je vais cueillir des fraises”.
La vérité, c’est que la cueillette, en ce moment, ce sont les besoins du temps de guerre.Cest une question de survie économique pour les agriculteurs désertés. .
Les fraises, comme les patates douces, les poivrons, les laitues et les olives, les grenades et les tomates, il n’y a plus assez de travailleurs pour s’en occuper.
Alors les gens des villes comme moi, on y va quand on peut, des heures de l’aube à midi ou toute la journée, une fois de temps et temps ou tous les jours pour certains, aider dans le champs.
On s’organise entre nous, groupes WhatsApp, une liaison avec un agriculteur dans le besoin, l’annonce d’un lieu, le type de travail, les heures, et hop, un groupe de Juifs de tous horizons se retrouve dans une voiture en direction d’une exploitation agricole aux petites heures du matin.
Vendredi dernier, l’hiver ne s’était pas encore installé. Les fraises avaient besoin de nous, et il fallait s’en occuper avant la claque du soleil de midi.
On était partis à cinq dans la voiture de Matias, un argentin qui a fait son aliyah (littéralement “montée” en Israël) il y a deux ans. Derrière moi, la française, deux américaines sur leur portable. Kibboutz galouiout (le regroupement des exilés).
Lorsque je leur demande ce qu’elles sont venues faire en Israël, l’une d’elles, visage de poupée à la peau lisse sous sa queue de cheval blonde, me répond d’un air candide “Je suis soldat.”
Elle a à peine vingt ans. Elle est venue toute seule servir ici en Israël, depuis Philadelphia où elle a grandi. Elle vit dans un kibboutz dans le nord et elle portera bientôt l’uniforme.
Presque tout comme Rosie, cette jeune hayelet bodeda, soldate solitaire, qui s’est fait poignarder la semaine dernière à Jérusalem, alors qu’elle montait la garde près de la vieille ville.
Ça leur a coûté la vie à tous les deux.
Elle vingt‐trois ans, lui seize.
Ils ne se connaissaient pas.
Ils n’ont même pas eu le temps de vivre.
Elle est morte pour la cause qu’elle était venue servir. Lui aussi.
La différence c’est que sa cause à lui, c’était de tuer. On lui avait appris que c’était son devoir, et son destin, de tuer, pour qu’il n’y ait plus de Juifs dans “son pays.” Quitte à en mourir. Que ce serait une grande gloire, de mourir pour Dieu.
Il n’avait pas eu le temps de se faire sa propre opinion.
Ce matin, ma cause à moi, c’est d’aider des agriculteurs.
J’essaie, impuissante, de contribuer comme je peux, àsoutenir un pays en guerre. J’essaiee faire ma part, si minuscule face à ceux à qui on a mis un uniforme et qu’on a envoyé là‐bas au front, à la vie à la mort. En allant cueillir des fraises, j’essaie de me défaire d’un peu de la culpabilité du survivant, et, aussi je l’avoue, je ne suis pas mécontente de sortir un peu de Tel Aviv et de me retrouver dans la nature.
J’aimais l’idée d’un verger, comme dans la photo postée par ma prof de yoga où on la voit cueillir des grenades à l’ombre des feuilles vertes.
On arrive au champ de fraises, et mon rêve bucolique s’envole.
Le champ est situé au bord de l’autoroute. Même si on ne la regarde pas, on ne peut l’ignorer, car on entend le bruit continu des voitures. Cette énergie unique et épuisante, du trafic produit un bruit de background qui n’a rien à envier avec l’avion au bruit bourdonnant qui tourne nuit et jour dans le ciel de Tel Aviv depuis le début de la guerre.
So much (Autant) pour le calme.
Et puis les fraises, elles poussent sur un sol recouvert de gigantesques sacs poubelles, afin que le sable dans lequel elles sont plantées ne dégringole pas.
Je me retrouve donc devant un paysage de plastique gris‐noir au soleil du petit matin, le plastique tiré parsemé des trous par où sortent les minuscules bouquets de tiges vertes qui nous attendent en rangées sages.
C’est à l’israélienne. Pas de présentations officielles. Pas de “quel est votre nom?”; pas de “merci d’être venus”, et tant mieux. C’est plus digne comme ça. On n’est pas là pour s’auto-congratuler. Et puis, pas le temps pour tout ça. Il y a du boulot.
On nous tend des cageots, chacun ses rangées, et c’est parti.
On se retrouve à marcher entre deux rangées du plastique anthracite luisant sans grâce sous le soleil qui monte, à traquer des yeux les points rouge sous les grosses feuilles vertes indiquant le fruit à peine assez mûr pour être pris, on se baisse, plan par plan, pour les arracher en douceur et les mettre dans notre panier – ou plutôt, dans notre cageot en plastique sale.
Je reste pourtant tellement contente de cueillir des fraises – les représentations ont la peau dure, que la chanson d’Ella Fitzgerald me trotte en tête toute la matinée :
“A-tisket, a-tasket
A brown and yellow basket”
“Un panier marron et jaune”
Au bout d’un momentmon panier est plein. Je suis épuisée, fière de moi, et prête à rentrer à la maison. Je regarde l’heure. Il est huit heures et quart. Cela fait à peine une heure qu’on est là, et on s’est engagés jusqu’à onze heures trente.
L’une des Américaines a sorti son téléphone, et de la musique pop israélienne sort de sa main libre. Cela faisait trop de silence pour elle. Il faut bien se distraire.
J’essaie d’ignorer le fait qu’elle a cru bon de mettre la musique nasillarde sur haut parleur plutôt que dans ses écouteurs, et je tente de m’arranger pour ne pas trop la croiser quand nos rangées de fraises pas assez mûres arrivent à la même hauteur, car j’apprécie infiniment ce silence.
On passe le reste de la matinée à s’enfoncer dans le sable, se baisser, se relever, puis ouvrir grand les bras pour parsemer les plants de pesticide biologique. Je me fais un bleu sous l’ongle de l’orteil à force de cogner contre mes vieilles baskets, j’aurai des courbatures aux triceps, chouette, le soleil commence à taper sérieusement, et je me dis, qui a besoin d’aller à la salle de sport quand on peut aller cueillir des fraises.
Celui qui nous explique l’art de la cueillette a des lunettes de soleil et une casquette, et une barbe déjà légèrement grisonnante au‐dessus de sa large poitrine recouverte d’un t‑shirt de sport.
Plus tard, je le verrai avec une toute petite fille dans son grand pick‐up blanc, entre les rangées de terre plastifiée des plants verts. Il avait dû la prendre avec lui au travail car personne d’autre ne pouvait s’occuper d’elle un vendredi matin.
En ce moment les enfants n’ont presque pas école. La plupart des profs sont en milouim(réserve militaire), ils ont été appelés à l’armée, et le gouvernement est trop débordé par d’autres urgences pour les remplacer.
Alors ils errent entre un Zoom par‐ci et par‐là, et entre deux, les adultes essaient de les occuper comme ils peuvent.
J’ai de la peine pour cette génération de petits, dont la vie a été mise entre parenthèses pendant presque deux ans de Covid, et maintenant, après les grandes vacances et les fêtes, toujours pas d’école depuis cinq mois. Et ce n’est pas près de se terminer.
En allant chercher mon sac à dos dans le bureau sans fenêtres au bout du hangar, je comprends que le gérant était dati, religieux : sur les murs du préfabriqué, un portrait de Baba Saleh, un psaume au mur. Je verrai plus tard sur la vitre arrière de son pick‐up, un autocollant s’adressant à tous ceuxqui le suivent : Todah, Aba (merci, papa) – le concept hébraïque de simplement remercier notre “père qui est aux cieux”, dont les Chrétiens ont fait depuis leur moto.
L’autocollant qui barrait sa porte de formica pour protéger l’espace bureau où l’air conditionné était allumé, disait ces mots de l’une des prièresles plus connues (Psaume 23): “Et même quand je vais dans la vallée des ombres de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi”.
Cette partie du psaume, que l’on chante chez nous avant de bénir le pain, le shabbat, résonne particulièrement en ce moment.
La vallée des ombres de la mort, on l’a traversée le 7 octobre, et on la traverse encore.
Je pense aux otages qui y sont encore. Combien encore vivants. Et dans quel état.
Ce psaume est pour eux.

Notre vie c’est des fraises
Et nous, pendant ce temps, on est vivants, et on cueille des fraises. À l’arrière-front, hormis les missiles, la solitude qui ronge celles dont le mari est au front depuis maintenant un mois, , l’inquiétude qui hante celles dont le fils ou la fille est au combat, ici, comme on dit en Israël : “Notre vie c’est des fraises” (haHaïm shelanou toutim).
Cette expression, je l’ai entendue juste la semaine dernière, sur Youtube, par un jeune à qui il manquait une jambe.
J’évite toujours à tout prix les vidéos amateurs des massacres ; je fuis les contenus qui semblent indiquer de la violence, y compris verbale ; je clique sur quelques unspour me tenir informée un minimum.
Je ne sais pas pourquoi j’ai cliqué sur celle‐là.
On y voit des jeunes en chaise roulante.
Ils ont l’air d’avoir la vingtaine. À tous il manque une jambe, parfois plus.
Ce sont des survivants de la messibat teva, le Festival Nova.
Ils sont dans leur centre de rééducation, et l’un d’eux, un grand maigre à l’allure nonchalante, l’une des jambes amputée pas loin du bassin, est en train de parler à quelqu’un de l’autre côté de la terrasse ombragée.
“Nous tous ici”, dit‐il en agitant sa cigarette, “le fait qu’on soit vivant, c’est un miracle.”
Il regarde autour de lui. “Un miracle. Un miraclequ’on ait survécu.
Alors t’inquiètes. À partir de là, tout est bon pour nous.
Notre vie, c’est des fraises.
Yalla, vas‑y”
Il jette sa cigarette d’un air nonchalant, et dirige sa chaise roulante vers l’autre côté de la terrasse.
La caméra bouge dans la direction de celui à qui il parle, et on voit le chanteur israélien Hanan ben Ari assis au milieu des jeunes amputés, avec sa guitare.
Cette star de la musique populaire israélienne a fait ce que tous font ici, en ce moment : “chacun vient offrir ce qu’il a à offrir.
Quentin Tarantino, mariée à une israélienne et qui passe une partie de l’année à Tel Aviv, est allé visiter les soldats gardant des villages près de Gaza ; Omer Adam offre un service de taxi gratuit aux soldats pour qu’ils aillent où qu’ils veuillent dans le pays lorsqu’ils ont une permission ; des comiques et chanteurs israéliens font le tour des bases pour des concerts et spectacles ayant pour objet de remonter le moral des troupes.
Et maintenant Hanan Ben Ari est venu tout simplement s’asseoir avec sa guitare, dans ce centre de rééducation physique, parmi les jeunes amputés.
“Ok” dit le chanteur dans un sourire, “c’est parti”.
Dans cette chanson ironique célèbre en Israël depuis années, ilnomme les difficultés du quotidien – se lever le matin, faire du sport, la queue à la poste, mais aussi les conditions de vie difficiles dans le petit état hébreu – le prix des loyers, le montant des taxes, les attaques terroristes… Chaque phrase est ponctuée par une exclamation kashé!, “c’est dur!”
Et voilà le refrain, qui vient contredire la complainte avec l’une de ces phrases clichés qui circulent chez les Juifs pieux :
“On n’a pas à se plaindre, tfou tfou hamsa baroukh haShem (béni soit dieu)” et le chanteur de conclure ironiquement “Notre vie, c’est des fraises”.
Parenthèse culturelle : Tfou tfou est une onomatopée désignant le geste de cracher pour se garder du mauvais œil. On crache avant de dire hamsa – “cinq” en arabe, le chiffre porte‐bonheur incarné dans le talisman des Arabes comme des Juifs, la fameuse main stylisée que l’on appelle en français “la main de Fatma.”
Cette expression est souvent utilisée par les Juifs séfarades traditionalistes lorsqu’ils parlent de la santé de leurs enfants ou de leur business et veulent remercier Dieu, tout en se prémunissant du mauvais œil. Alors on introduit le “Béni soit Dieu” par un rapide tfou tfou (je crache) hamsa (talisman).
Hanan Ben Ari commence à chanter, et les jeunes répètent en choeur énergiquement le Kashé!(“c’est dur!”) qui ponctue chaque phrase.
Lorsqu’arrive le refrain, celui qui parlait au début, maintenant tout près du chanteur, commence à lever les bras en rythme.
« On n’a pas à se plaindre, tfou tfou hamsa, beni soit dieu, notre vie, c’est des fraises »
Il danse avec les bras à l’orientale comme le veut la chanson, et soudain il se lèvesur son unique jambe, et continue avec ses hanches, appuyé sur son fauteuil et sur le pied qui reste célébrant la vie, narguant le handicap, montrant au ciel et aux hommes comme il continue de danser, comment il continuera, à danser.
Cette façon de célébrer la vie malgré les brisures, est l’une des plus grandes forces des jeunes israéliens.
Malheureusement, ils n’ont pas le choix.
Enrôlés à l’armée dès dix‐huit ans qu’ils le veuillent ou non, jetés trop souvent dans des opérations d’une violence qui en laisse plus d’un traumatisés à vie, ils ont appris à narguer le désespoir en revendiquant la vie.
Cela explique une certaine insolence israélienne qui agace tant le monde, des chemins de l’Inde aux sites touristiques à New York ou Amsterdam
Et pourtant j’imagine que les jeunes que l’on voit sur ce court extrait vidéo, qui célèbrent, le fait d’être vivants, gratifiés de la présence de l’un des chanteurs israéliens les plus populaires du moment, n’ont pas toujours été dans le même état d’esprit depuis le 7 octobre.
Je les imagine seuls dans leur lit, le lendemain. Et depuis, le matin au réveil ou le soir lorsqu’il faut bien dormir.
Je les imagine se voir un bras ou une jambe arrachés par une grenade lorsque les terroristes les ont pris par surprise à l’aube lors de la fête du désert.
Ou amputés médicalement à la suite de leurs blessures.
Seuls dans un lit d’hôpital, hébétés, regardant sans comprendre le vide nouveau, absurde et implacable, à la place d’une partie de leur corps.
Aujourd’hui, avec les nouvelles informations que l’on a, j’ai compris que nombre de ces amputations n’ont pas été des accidents ou la suite de blessures.
J’ai appris que les mutilations ont fait partie des attaques : les terroristes passaient parmi les morts et les vivants et coupaient au hasard, ivres de drogues et de vengeance, ici un bras, ici une jambe, ici un sein de femme.
Ils coupaient pour marquer les vivants comme les morts. Pour continuer de leur porter atteinte, en continu, comme ils l’ont fait lorsqu’ils ont laissé leur sperme sur les reins d’une petite fille morte. comme une signature.
Pour laisser des traces.
La trace
J’imagine ces nouveaux mutilés dans leurs moments de solitude, leurs pensées, le désespoir qui a dû les saisir, et qui les saisira encore.
Comment jouer encore au foot, au volley sur la plage de Tel Aviv.
Comment faire l’amour.
Comment, quand c’est le bras qui est parti, conduire une voiture. Cuisiner. Écrire. Partir en randonnée. Porter un enfant.
Et pour tous : le regard des gens.
Pour toujours. Les regards commiséreux. Les regards effrayés. Les enfants qui montrent du doigt. Les chuchotements. Les questions qui reviennent, ou pire : celles qui n’osent pas être posées
Les regards qui s’intercaleront toujours, entre eux et les inconnus qu’ils croisent, à vie, et qui parlent trop fort à travers leur silence.
Pour nous, c’était l’attaque d’un jour.
Pour eux, la trace est pour toujours.
Bien sûr, nous aussi, on en gardera toujours une trace, une trace psychologique. Une mémoire collective, que l’on cultivera activement, en allumant une bougie chaque année, pour ne pas oublier.
Eux, ils feront tout pour oublier.
Nous, dans un certain sens, on est déjà un peu passés à autre chose.
Aujourd’hui c’est l’ampleur globale de la violence de l’opinion internationale, les actes antisémites de par le monde, le déni des violences subies, le cynisme des accusations, les répercussions de la guerre, qui nous occupent.
Pour nous les épargnés, le choc du pogrom a eu la gentillesse de se pousser un peu dans notre esprit pour faire de la place à d’autres :
Le choc devant le constat de la remontée d’un antisémitisme de masse désormais désinhibé ;
la douleur de voir les crimes sexuels commis sur les femmes déniés ;
l’inquiétude de voir certains colons en Cisjordanie s’attaquer par vengeance à des Palestiniens dans leurs champs en pleine récolte des olives, comme si cela allait ramener nos morts et nos suppliciés. Comme si ça allait nous venger du Hamas…
Comme si cela allait changer ce qui s’était passé…
Comme si on pouvait prétendre avoir le droit de vivre en paix chez nous si on le déniait aux autres…
Comme si ces actes violents de désir d’épuration ethnique, ceux‐là même pour lesquels on se bat pour notre droit à exister, n’allaient pas nous nuire à nous aussi,et tout empirer, de nos relations avec les Palestiniens à notre image déjà bien endommagée dans l’opinion internationale…
L’actualité chasse l’actualité, et chaque jour, on entend des noms nouveaux.
Les noms de cadavres enfin identifiés.
Les noms de soldats morts chaque jour, des gamins que l’on envoie tuer et se faire tuer pour que nous, les Israéliens, puissions rester vivants, pour que nous, les Juifs, puissions continuer à avoir un pays.
Pour moi, un nom, c’est un moment de tristesse. Puis un autre vient le remplacer.
Pour une mère, une fiancée, un mari, un frère, un ami, de l’un de ces noms, ce nom prononcé, c’est un son indélébile. Tout s’arrête, le quotidien n’a plus de sens, et la vie ne sera plus jamais la même. Le cours de l’existence a été détourné.
Qu’on le veuille ou non, il faudra repartir de là.
Pour ceux qui ont survécu aux atrocités, pour ceux qui sont sur un lit d’hôpital, pour ceux qui ont quelqu’un en otage, pour ceux qui sont en deuil, quelque chose s’est arrêté là.Ils en porteront une marque à vie.
Je me souviens de Rouge décanté de Jeroen Brouwers.
Dans ce livre qui m’avait beaucoup marquéeà l’époque, , l’écrivain néérlandais raconte ses souvenirs d’enfant interné, dès l’âge de trois ans, dans un camp de concentration japonais dans ce qui était alors l’Indochine, pendant la seconde guerre mondiale.
En raison de son jeune âge, Brouwers avait été interné avec les femmes – sa mère, sa grand‐mère, et sa sœur.
Il était revenu seulement avec sa mère.
C’est un livre sur la sauvagerie humaine et sur les marques qu’elle laisse à vie : le traumatisme.
Brouwers raconte comment il a vu sa mère, à terre, nue, rouée de coups, sanguinolente, le vagin broyé par des coups de bottes qui visait le trou par lequel sort la vie, et par lequel peut entrer l’amour, ou les pires abus.
Comme des rats. C’est ce qu’ils faisaient, les Japonais, pendant ces années de guerre. Ils faisaient entrer des rats affamés dans les vagins des femmes.
Ils mettaient les femmes dans les fours. Et d’autres choses que j’ignore.
Il est intéressant de noter qu’il ne reste nulle trace de ces événements dans l’inconscient collectif global, quant à l’image que l’on a des Japonais en tant que peuple et culture.
Et voyez l’image des Musulmans.
Et voyez l’image d’Israël dans le monde.
Tout est une question d’image.
Le monde juge sur des images.Dire les faits, c’est tenter de les déconstruire un peu.
J’ai personnellement une réelle affinité avec le Japon. Cela n’empêche qu’il faut dire les faits. De même qu’en tant que Juive et Israélienne, il est de ma responsabilitéde dénoncer tout abus faits par les miens.
De même qu’il faut dénoncer aujourd’hui les violences et les manipulations du Hamas, ainsi que l’hypocrisie malveillante d’une partie de l’opinion internationale.
À chacun la responsabilité de jeter la lumière sur ses propres parts d’ombre, et à nous, en tant qu’humains, de nous souvenir que l’on a une responsabilité collective et individuelle, les uns envers les autres.
Cela commence par l’honnêteté intellectuelle, au prix des idéologies.
C’est pourquoi même si je pense qu’une reconnaissance de la sauvagerie du Hamas et de ceux qui se réjouissent avec eux est urgente, il me semble important de relire Browers en ce moment, ne serait‐ce que pour se décoller de l’obsession actuelle sur un monopole de la violence attribué à la culture arabo‐musulmane.
Lorsqu’on parle de totalitarisme, de torture et de trauma, lorsqu’on parle de cruauté, on parle d’abord de l’Humain.
Le trou
La phrase que Brouwers appose en incipit de son livre pourrait être la meilleure définition du traumatisme :
“Nulle chose n’existe qui ne laisse de trace.”
La double négation est éloquente. Elle insiste sur cet aspect puissant du traumatisme : rien n’y échappe.
Insaisissable, impalpable, inéluctable, le traumatisme règne partout sans pouvoir être saisi nulle part. Il nous marque à travers ce qu’il laissedans son sillage : une trace doublement négative : rien n’y échappe ; tout est marqué.
Le traumatisme, c’est une trace.
Or cette trace, cette cicatrice, parfois, indélébile dans les corps comme dans les âmes, c’est souvent un trou.
Un trou dans le corps des mutilés.
Un trou dans le visage, pour ceux qui ont perdu leurs yeux.
Un trou dans la peau, pour ceux qui ont été brûlés à vif.
Un trou dans le rapport au monde, pour ceux qui militaient pour le bien‐être des Palestiniens et qui ont été tués ou enlevés, abusés et maltraités par ceux qu’ils essayaient, de toutes leurs forces, d’aider.
Un trou dans le coeur, pour ceux qui ont perdu leurs amis, leurs voisins, leur famille.
Un trou dans les biographies.
L’une des élèves de ma prof de yoga, habitante de l’un des kibbutzim du Sud attaqués le 7 octobre, a survécu avec ses quatre enfants. Son père a été pris en otage à Gaza, et les trois quart de sa communauté sont morts.
Alors qu’on lui dit “mais tu as survécu, réjouis toi!”, elle reste prostrée.
Quelque chose en elle est mort. Et elle reste là devant ce trou béant, tentant encore de comprendre ce qui s’est passé.
Le week‐end dernier j’étais en retraite de méditation bouddhiste en Israël.
Le vendredi soir, on a allumé des bougies et on s’est assis autour.
L’une des participantes a éclaté en sanglots. Un bon ami à elle a disparu, on ne sait s’il est mort ou s’il a été enlevé. Son fils de douze ans, qui est dans la classe de sa fille, est là‐bas, avec les otages, à Gaza.
Stéphanie, ma belle‐sœur, nous a envoyé une photo où on les voit en randonnée, elle et son mari, avec un autre jeune couple souriant.
Une famille entière, les parents et les deux enfants, rayés d’un coup de la surface de la Terre.
Un trou dans la généalogie.
Ariel est un jeune garçon de douze ans, qui a perdu son père, sa mère et ses deux sœurs, en l’espace de quelques minutes. Il a survécu au pogrom ce matin‐là car il n’était pas chez lui.
À quelques mois de sa bar mitsva, il se retrouve seul.
Heureusement il a encore son grand‐père, un rescapé de la Shoah, qui lui aussi s’était retrouvé seul au monde à l’âge de quatorze ans. Miroir dans la généalogie, répétition de l’Histoire.
Le grand‐père lui dit : “Voilà tu es comme moi maintenant. Seul au monde. Mais tu verras. Tu es fort. La vie continue, tu vas pouvoir reconstruire.”
Reconstruire à partir de ce trou béant.
J’entendais l’autre jour l’interview d’une médecin pédiatre qui avait recueilli les enfants blessés survivants des attaques du 7 octobre.
Elle disait tristement : “Je crois qu’ils ne seront jamais bien, après ce qu’ils ont vécu. Je crois que c’est fini pour eux, dans cette vie”.
J’aimerais tellement que le futur la démente.
L’une des petites emmenées en otage a eu quatre ans pendant sa détention.
Abigail est devenue orpheline en deux minutes. Sa mère avait été tuée sous ses yeux, puis son père, par une balle dans le dos alors qu’il la tenait dans ses bras pour la protéger de son corps. Tombée avec lui, elle a survécu sous le cadavre sanguinolent et s’en est extirpée pour aller courir chercher refuge chez des voisins. Ils ont été pris en otage, cette famille, et puis elle, toute seule à Gaza.
Maintenant qu’elle en est sortie, le reste de sa vie commence à partir de ce trou béant.
Bien sûr elle va aussi porter la trace du traumatisme. Le choc de l’intrusion d’hommes masqués et armés dans sa maison, à l’aube d’un shabbat. Les images de ses parents tués, le sang. Sa captivité.
Elle devra vivre avec le double défi du trou de l’absence, et des traces de la mémoire.
Pendant qu’Ariel, Abigail et tant d’autres restent là, à tenter de faire sens de ce qui vient de leur arriver, de jeunes étudiants enthousiastes sur des campus privilégiés crient Allahou akbarou chantent “from the river to the sea”.
Ils exigent, au nom de la lutte contre une guerre impossible, dans laquelle les tueurs se placent au milieux de civils afin que leurs fans du monde entier puissent crier au “génocide”, il exige qu’un pays entier soit rayé de la surface de la terre,.
En réponse à un génocide fantasmé, l’appel, diffusé sur les télés du monde entier, est celui d’un génocide réel.
Je reviendrai plus tard sur la définition du mot “génocide” et ces questions de qualifications du réel devenues de véritables enjeux sociétaux globaux – ce que j’appelle la guerre terminologique.
En attendant, l’armée israélienne, pour imparfaite et susceptible d’abus qu’elle est, comme toute institution humaine dotée de force de coercition, continue de prévenir les habitants de Gaza avant tout bombardement, continue de pratique les attaques chirurgicales au prix de la vie de ses propres citoyens chaque jour, continuer d’aider les citoyens gazaouis à évacuer alors que le Hamas les en empêche afin de garder ses boucliers humains et ses arguments de meurtre en masse, et continue de perdre ses soldats en essayant d’épargner les civils palestiniens, au prix d’épargner les terroristes qui continuent de se cacher, et qui continuent d’attaquer.
Chaque jour les missiles continuent de tomber sur Israël, chaque jour des israéliens qui s’aventurent dans Gaza miné, dans ce jeu de cache‐cache qui a tué le peu d’éthique qu’il y avait dans la notion de guerre, d’armée et de champ de bataille, meurent.Il n’y a plus de champ de bataille. Le Hamas se bat au milieu des siens pour mieux gagner, grâce à leur mort, la guerre médiatique.
Et en attendant, les miens continuent de mourir.
Et plus les jours passent, plus la liste s’allonge.
Le jour de son anniversaire, le 13 novembre dernier, Matan est allé à l’enterrement d’un ancien collègue de l’armée.
Ils avaient fait leur service ensemble. Ils avaient partagé la même chambre pendant six mois. Il s’appelait Matan aussi.
Il n’avait rien demandé. Il a été appelé, pris à sa vie et à son travail, envoyé à Gaza pour défendre les frontières violées de son pays. Il y est mort.
Matan m’a envoyé une photo de l’enterrement, dans le kibboutz des parents de l’autre Matan, le mort, dans le Golan non loin de la frontière syrienne.
Un jardin, des drapeaux, des gens debouts, de tous âges, venus honorer et dire un dernier au‐revoir à celui qui s’est battu pour eux, et qui est maintenant porté en terre.
Matan, le mien, n’a pas été appelé à l’armée.
Il aurait pu l’être.
Ça aurait pu être lui.
“Qui vivra, qui mourra.”, Ounetané Tokef continue de chuchoter à mon oreille.
On ne sait rien. On ne contrôle rien.
On n’est rien.
Et on fait beaucoup de bruit.
La liste est longue, de ces trous‐traces, de ces vides qui nous marquent, et qui en marqueront beaucoup à vie.
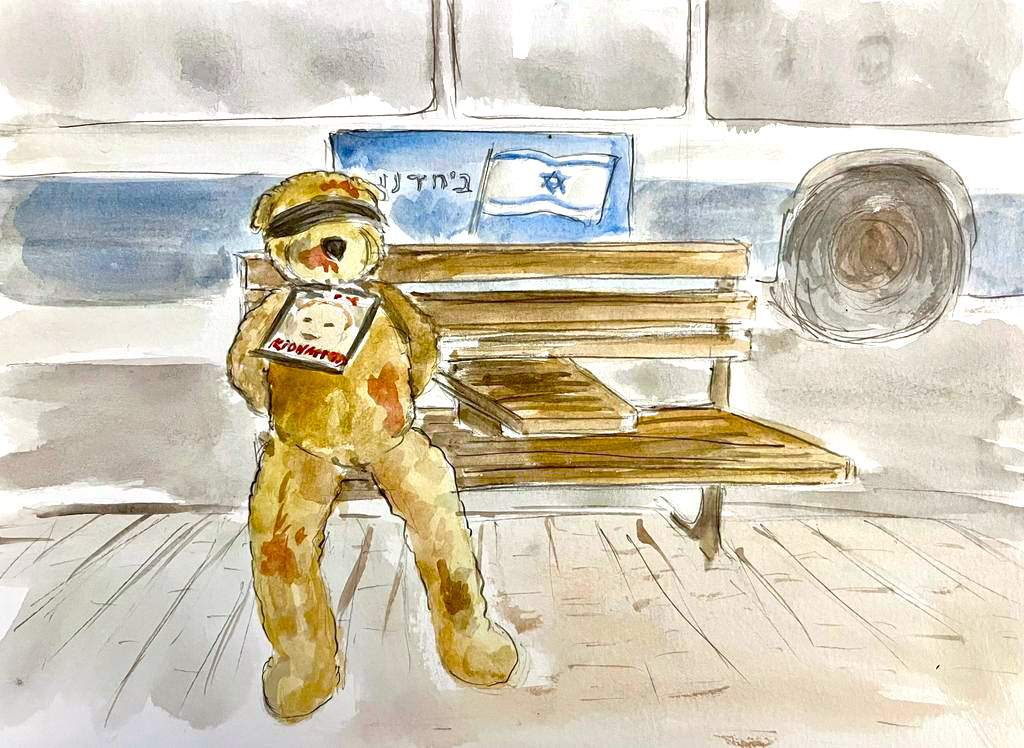
L’absence
Yehoshua (littéralement “le salut”) porte bien son nom.
L’un des participants de la retraite bouddhiste à laquelle j’étais fin novembre, il est très engagé dans l’activisme pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il passe du temps chaque semaine à prendre des enfants de Gaza en voiture pour les amener se faire soigner dans des hôpitaux israéliens.
Il me parle de son partenaire bénévole, celui qui faisait la partie retour du chemin, un vieil homme dévoué à réparer les injustices et à soutenir les Palestiniens. Il me dit que ce vieil homme de plus de quatre‐vingt ans a été pris en otage à Gaza.
Ce vieil homme c’est Oded Lifhshitz, le mari de Yo’heved, l’une des deux otages israéliennes libérée après quinze jours de détention.
Il me parle de leur troisième partenaire qui, elle, est morte, brûlée chez elle.
“D’elle il ne reste même pas une dent”, dit‐il tristement.
“Elle”, c’est Vivian Silver. Antoine Strobel‐Dahan, rédacteur en chef de Tenou’a, lorsqu’il a appris que les traces de son corps brûlé avaient été identifiées, lui a dédié un texte plein de tristesse et d’amour : “Mort d’un poème“.
“Il aura fallu cinq semaines pour identifier son corps”, écrit‐il laconiquement.
Car plus d’un mois après le massacre, il reste encore nombre de corps non identifiés. Trop en miettes, trop brûlés.
Le travail d’identification des cadavres, toujours en cours, a été remis entre les mains des archéologues. Ils font des correspondances d’ADN à partir de morceaux d’os, de crâne, la seule chose qui reste.
Quelle cruelle ironie que ce soit souvent parmi les plus dédiés au bien être des Palestiniens, des activistes qui y croyaient de tout leur être, qui ont été massacrés ou enlevés ce jour‐là..
Pour certains, il faudra s’habituer à vivre avec le trou du manque, du deuil. Le deuil des êtres, mais aussi, ce dont on parle moins, le deuil des choses.
Une maison brûlée. Toutes les affaires brûlées. Plus rien.
Et puis devoir trouver où aller.
C’est le cas de tout un pan de la famille de mon ami Yaniv, qui enseigne à l’université de Beer Sheva. Ses parents, des immigrés modestes venus de Tunisie, avaient été jetés à Ofakim, ces villes pauvres du Sud dans le désert ingrat, où l’on parquait, dans les années soixante, les olimplein d’espoir venus du Maghreb.
Les parents de Yaniv sont restés sains et saufs cachés dans leur maison, mais leurs voisins ont été pris en otage.
Et les cousins de Yaniv, dans leurs différents villages, ont perdu leur maison.
Brûlée. Il ne reste plus rien.
Lila Kimchi, une enseignante bouddhiste israélienne, a partagé l’écrit d’un habitant du Otef Azza (la zone entourant Gaza) qui avait survécu au 7 octobre.
C’est la reprise d’un fameux Haïku du XVIIe siècle, par le poète Japonais Mizuta Masahide. (Les Haïkus sont ces pomès ultra courts en douze syllabes, qui témoignent de l’art de l’esquisse japonais et de l’éloquence dans le minimalisme). Voici le Haïku original :
La grange est brûlée.
Maintenant je peux voir la Lune.
Voici celui de l’israélien survivant :
La maison est brûlée.
Maintenant je peux voir Gaza.
Gaza…
Est‐ce que l’on ne la voyait pas, avant ?
Est‐ce que les habitants juifs qui faisaient face à la bande de terre habitée la plus explosive du moyen orient ne voyaient pas le danger ?
Voulaient‐ils trop croire à la coexistence ?
Pour nous, les épargnés, le 7 octobre restera un souvenir. Un souvenir douloureux, mais qui s’effacera, qu’on le veuille ou non. Alors le 7 octobre prochain, on allumera une bougie, pour nous aider à nous souvenir.
Pour eux, il s’agira plutôt d’essayer d’oublier, de temps en temps. Juste pour avoir la possibilité d’un sourire.
Eux, les voilà assis devant le trou béant que le massacre a laissé dans leur vie.
L’autre jour, jeudi soir, Matan est moi sommes allés sur ce qu’on appelle désormais Kikar haHatufim, “la place des otages”. Derrière la Kiria, la grande base militaire urbaine de Tel Aviv où elles campent depuis le 7 octobre, les familles des otages ont investi l’espace de l’esplanade devant le musée d’Art Moderne. C’est là que l’installation de l’immense table de shabbat vide, soigneusement dressée, avec de vraies bouteilles de vin et de vraies hallot, et de vraies pommes, vient nous parler d’amour et de douleur.
Ils sont là toute la journée, ensemble, manifestant, attendant. Car que pourraient‐ils faire d’autre ? Aller au travail ? Faire les courses ?
Le vide dans les maisons doit être intolérable. Les affaires des enfants, la table du dîner vide, le silence… alors ils sont dehors.
Tout le reste semble absurde.
On arrive Matan et moi, il y a du monde sur toute la place, par grappes. Un groupe est assis en demi‐cercle et écoute un concert improvisé. Une femme chante des chansons israéliennes à la guitare, tandis que sur l’écran à sa gauche défilent non‐stop les photos des otages, avec leur nom, et leur âge.
Pas d’applaudissement entre les chansons. Ce n’est pas un concert. On chante ensemble pour se réchauffer un peu l’âme.
Et puis, ça occupe. Cela fait passer le temps. Les soirées interminables. Les jours d’agonie, d’une attente qui ne sait même pas si elle doit être appelée attente.
La torture de l’incertitude. Sont‐ils vivants, sont‐ils morts ?
Vivants, dans quel état ?
Comment sont‐ils traités ?
Savent‐ils que l’on pense à eux ?
Vont‐ils revenir un jour ?
Combien de temps faudra‐t‐il continuer à attendre ?
Vont‐ils mourir dans une attaque de Tsahal ou sous la main de leur geôlier ?
Après la libération de quatre otage, 17 jours après leur enlèvement, un mince cil d’espoir avait secoué les corps des familles fantômes.
Hamas acceptera‐t‐il de libérer aussi les miens ? Qui sortira ?
Et dans quel état ?
Certains, la photo de leur bien aimé en pancarte énorme autour du coup, déambulent parmi la foule des proches atterrés ou des visiteurs émus
Je vois une famille serrée, le père, la mère, un fils adulte, grands et maigres, serrés, les uns contre les autres derrière le demi‐cercle qui fait face à la dame à la guitare, ils chantent avec elle, avec toute la foule, ces chansons israéliennes d’avant qu’ils semblent tous connaître.
Ils chantent la bouche serrée, les yeux dans le vague, le même regard de noyé, les yeux embués, comme d’autres que je vois circuler comme des zombies dans la foule qui ne peut pas grand‐chose pour eux.
C’est à cela que je repère les familles des otages, par rapport aux gens comme Matan et moi venus leur offrir un peu de notre présence, l’illusion d’un maigre soutien – et le vague espoir de soulager un peu notre propre conscience.
Lorsque je vois ces pères, ces mères, petits copains, ami, frère, soeur, tante, grand‐mère, ami proche, hagards, paralysés, dont la vie s’est arrêtée depuis un mois, qui ne peuvent faire autre chose que se tenir là, sous le soleil du jour et les lampadaires la nuit, attendant, c’est tout, attendant, j’espère qu’ils ne regardent pas les infos.
J’espère qu’ils ne voient pas les manifestations de milliers et les cris de haine. J’espère qu’ils ne voient pas les posts sur les réseaux sociaux d’une actrice porno libanaise qui demande aux Hamas d’envoyer les vidéos en horizontal pour qu’elle puisse mieux voir les suppliciés. J’espère qu’ils ne voient pas le masque froid de haine et la main rageuse de bons fonctionnaires français, de brillants étudiants américains, d’honnêtes employés français, allemands, russes, italiens et j’en passe, investis de leur juste indignation contre les brutal Israël colonial et portés par la noble lutte pour la libération des peuples indigènes contre le sionisme conspirateur qui détient le monde, arrachant avec une colère bien‐pensante les affiches des leurs bien‐aimés otages, tant on ne veut pas voir des visages d’Israéliens qui seraientvulnérables. .
C’est impossible. Le coupable ne peut pas être victime. Alors pour ne pas voir, on arrache les images.
J’espère que les familles ne voient pas ces tentatives d’effacement des traces, ces papiers fragiles comme les témoins vivants de ce qu’ils traversent.
Pour d’autres, la trace laissée par les attaques est aussi sur le corps.

Le sang
J’écris ce matin, dans l’aube chargée de nuages, avec un doigt en moins.
Ce n’est qu’une petite coupure, juste sur la pointe du majeur de la main droite, celui que j’utilise en guise de souris de clavier. Mais c’est aussi celui avec lequel, suis‐je en train de me rendre compte, je tape le plus. Apparemment, je n’utilise jamais l’index, que je m’évertue désormais à mettre à contribution à la place.
Alors j’écris environ trois fois plus lentement. Et le temps est tellement court. Et j’ai tellement à dire.
Pour moi, ce n’est qu’une minuscule blessure embêtante. Une légère perte de temps. C’est dérangeant comme un moustique persistant. Je sais que cela va passer dans quelques jours. Dans ces moments‐là, je me rappelle toujours à quel point même le plus léger “handicap” physique change nos vies. Nos habitudes. Nos aises. L’efficacité. La possibilité de faire des choses.
Alors je pense à ceux qui sont marqués à vie.
Hier cela saignait fort, cette minuscule coupure.
Je me la suis faite après avoir vu une photo de l’énorme tache de sang sur le pantalon de Naama.
J’ai tout fait pour éviter de voir certaines photos, d’entendre certains récits.
Et voici que sans le voir venir, en postant un lien du podcast de ce carnet sur un groupe Facebook francophone, mes yeux sont tombés sur la photo – ou plutôt trois photos, et un texte.
Le texte est le commentaire d’une femme dénonçant le silence, puis le déni de l’ONU et des organisations féministes à propos des violences sexuelles faites aux femmes israéliennes depuis le 7 octobre.
Ce triste triptyque montre d’abord une photo de la jeune fille souriante – dix‐neuf ans, encore une enfant.
Les deux autres photos sont des clichés pris lors qu’elle a été emmenée. Dans la première, on la voit de face, poussée à avancer, les mains liées.
Dans la seconde on la voit de dos, poussée par la nuque à monter dans un pick‐up. Des grosses traces de sang balayées par la poussière partout sur les bras. Et surtout, une énorme trace de sang et de terre déjà noircies sur son jogging, qui couvre tout le derrière, autour de ses fesses.
Naama n’est “que” l’une des victimes sexuelles du Hamas.
Le féminicide de masse et les sévices sexuels visant les femmes qui a eu lieu le 7 octobre et est l’un des phénomènes les plus marquants de ce massacre.
Un collectif d’intellectuels et d’artistes français en témoigne lors d’une tribune publiée le 10 novembre dans Libération, mettant des mots sur ce que le gros de la société civile et des institutions internationales respectables – y compris des organisations pour la défense des femmes –, s’obstine à taire :
“Des femmes ont été exhibées nues. Des femmes ont été violées au point de fracturer leurs bassins. Leurs cadavres ont été violés également. Leurs organes génitaux ont été abîmés. Ils ont uriné sur leurs dépouilles.
Certaines ont été décapitées, d’autres démembrées et brûlées.
D’autres encore ont été prises en otage.
Tout cela a été filmé et pris en photo (…)
Un tri dans les otages femmes a même été fait, les belles d’un côté ont été emmenées, et les autres tuées. Des femmes handicapées aussi ont été violées et tuées comme Noya, autiste, et Ruth, polyhandicapées.”
Je le reproduis tel quel car c’est trop difficile pour moi à écrire.
Je savais que tout cela avait eu lieu – cela avait‐il encore lieu, pour les otages ?
Naama, lorsque j’écris ces lignes, est encore “là‐bas.”
Est‐elle encore vivante ?
A‑t‐elle vu la lumière du jour depuis le 7 octobre, ou est‐elle restée dans les tunnels ?
Comment est‐elle traitée ? La laisse‐t‐on tranquille ?
J’avais tout fait pour ne pas voir de trop près.
Cette photo m’a fait mal.
Je pense, au‐delà de l’humiliation et de la violence symbolique du “viol”, pragmatiquement, à la douleur physique.
Naama était‐t‐elle vierge ?
Tout ce sang…
Je pense à la douleur pas seulement sur le coup, mais aussi à la douleur d’après :
les infections, les lésions, la douleur particulière d’être blessé sur les parties génitales. S’est-elle retrouvée avec une infection vaginale ou urinaire ? A‑t‐elle accès à des soins ?
Et peut‐être que ce type de désagréments génitaux ne sont que les moindres du type de traces sur le corps qu’ont laissé sur certaines, parfois de manière indélébile, ces moments de violence inouïe survenus avec la violence de la surprise.
Voici quelques‐uns des comptes‐rendus que l’on peut lire par ceux et celles, témoins, policiers, médecins, volontaires de Zaka, qui listent le type de violence porté aux femmes‐ toutes les femmesdes petites filles aux vieilles dames, par le Hamas.
La violence du viol au point de briser des bassins.
Des pelvis fracturés.
“Des jambes tellement brisées” par le viol reporte Michal Kotler‐Wunsh devant l’Unesco dans un discours où elle dénonce l’antisémitisme d’une institution censée soutenir les Droits de l’Homme –“qu’on ne pouvait les redresser pour enterrer les corps.”
Des organes génitaux mutilés.
Le Parisien vient de publier l’interview d’une survivante du Festival Nova, “violée et mutilée” et laissée pour morte quand elle s’est évanouie de douleur.
Voir la photo de la jeune Naama emmenée avec son pantalon maculé de sang m’a rendue malade. Et je sais que je n’ai rien vu.
Les photos qui ont circulé, les vidéos des femmes en train de se faire violer, certaines déjà amputées, les cadavres, dont certains à moitié brûlés, en train de se faire violer.
Tout cela, je n’ai pas vu.
Devant le déchaînement de l’antisémitisme, le déni du grand public des horreurs subies, et une incapacité d’empathie glaçante par les occidentaux comme il faut, le gouvernement israélien avait eu pour projet de partager auprès du grand public un montage d’extrait de vidéos des viols, tortures et meurtres filmés en direct par les perpétrateurs du Hamas.
Le ministère de la Santé israélien s’y est opposé. Au nom de la santé mentale du public, ils ont demandé de ne pas rendre publiques ces archives, dont certains pensaient qu’elles auraient pu, peut‐être, apporter à Israël, et plus largement aux Juifs, quelque empathie dont l’absence, voire l’inverse, est frappante.
Nombre de ceux qui ont vu ces images sont depuis sous médicaments, disent les psychologues.
Moi je n’ai vu qu’une énorme tâche de sang sur les fesses d’une gamine de dix‐neuf ans menottée.
Et j’ai dû faire des sessions d’EMDR.
En attendant, alors que je m’évertue d’ordinaire à prendre soin d’intégrer pour ne pas somatiser, cette fois‐ci je n’ai pas pu.
Je me suis levée de mon bureau et suis allée voir Matan. En bon Israélien, il m’a dit de toughen up (me renforcer).
Je suis allée machinalement laver un plat à gâteau en verre sur lequel collaient encore les miettes du gâteau de shabbat.
La lourde assiette m’a glissé entre les mains et s’est cassée dans l’évier.
En ramassant les gros bouts de verre, j’ai coupé le haut du majeur de ma main droite.
Ça y est, moi aussi, je saigne, me dit mon inconscient.
Il fallait, cette fois, que ce soit littéral.
Somatisation
On est nombreux à avoir somatisé, depuis le 7 octobre.
Ce jour‐là, après avoir entendu les nouvelles atroces, alors qu’elle était en vacances en Amérique, une copine israélienne de mon ami Mathieu a fait une fausse couche.
Elle ne le savait pas encore. Elle ne l’a su que quelques jours plus tard, quand il a fallu expulser le fœtus sanglant. Il était pourtant presque prêt à vivre, mais sa vie s’était interrompue avant de commencer, quand le cœur de sa mère s’étaitarrêté en entendant l’horreur.
Elle n’avait pas réalisé, ce jour‐là, qu’elle en perdait son enfant.
Elle se souvient seulement de s’être dit alors : “À quoi bon mettre des enfants au monde, dans un monde comme ça?”.
L’un des élèves de Maya, ma prof de yoga, lui aussi son cœur s’est arrêté en entendant ce qui se passait.
Littéralement. Il en est mort. C’était quelqu’un, me disait Maya, qui vivait dans l’angoisse. Il avait grandi au nord d’Israël près de la frontière libanaise, familier, pendant la guerre du Liban, des attaques de missiles. Il s’était retrouvé tout seul un jour à l’âge de 6 ans quand un gros missile était tombé juste devant lui. Depuis, il vivait en post‐trauma, était devenu assez d’extrême à droite, haïssait les Arabes, et vivait dans la peur. Les attaques du 7 octobre ont eu raison de sa vie.
Ma copine Sarah, le lendemain du 7 octobre, elle a eu une douleur atroce dans le ventre. Elle a fini par aller se faire faire une échographie. Un kyste était soudain apparu.
Devant sa détresse et sa peur les premiers jours – et si les Arabes de Jérusalem se lèvent contre nous comme ils l’ont fait dans le Sud ? – son mari, un Israélien qui en avait vu d’autres, lui avait dit que c’était la guerre, et que tout cela, ces émotions, ces peurs, ces échaffaudages de scénarios possibles, ce serait pour « après ».
Là, c’était la guerre : il fallait “rester froid”, et “faire ce qu’on avait à faire”.
N’empêche que le lendemain il s’est cassé le bras, qui est toujours dans le plâtre, et il a aujourd’hui toujours l’œil gonflé par une infection oculaire qui ne part pas.
Et puis lorsque son fils, un gamin de dix‐neuf ans, spécialiste du déminage dans les tunnels, a été envoyé à Gaza – où il est toujours, il a commencé à avoir une allergie. Un urticaire sur tout le corps qui le démange en permanence et le laisse sans répit.
Pour d’autres au contraire, c’est la paralysie.
La mère de Matan, après avoir entendu l’enregistrement d’une conversation téléphonique d’un jeune « combattant de la liberté », en est tombée debout. Elle venait d’entendre la voix emplie d’émotion du jeune tueur qui appelait ses parents restés à Gaza, partageant avec eux l’heureuse nouvelle, comme s’il venait de recevoir le prix Nobel « maman, papa ! J’ai tué des juifs ! Avec mes propres mains ! J’ai tué des juifs ! »
Elle s’est levée de son canapé, paralysée, a buté sur ses chaussures sur le sol, est tombée en avant, et s’est cassé le pied.
Il n’y avait pas trop de développements sur la libération d’un territoire ou la victoire sur une armée d’occupation, dans ce discours d’enfant fier d’avoir comblé les attentes de ses parents et de sa société. Simplement la joie du destin accompli : « tuer des juifs. »
Ma copine Gaelle me parle de son grand‐père, un survivant de la Shoah qui vit à Jérusalem : “Il n’arrivait plus à marcher”, me dit‐elle, en m’expliquant que sa mère, en plein feu des premières semaines de guerre, est venue de France prendre soin de son père. “Il était sidéré.”
Pour d’autres, arrêter tout mouvement était un choix.
L’empreinte
C’est le choix qu’a fait Yarden, en l’honneur de qui un groupe de femmes a fait une flash mob. On y voit des femmes debout dans la rue qui soudain se mettent les mains sur la tête et s’agenouillent, pendant que la voix off dit “I surrender. Take me”.
“Je me rends, prenez‐moi”.
Yarden, raconte la voix off sur le site Instagram de Stand with us (“Soyez à nos côtés”), un site américain de soutien à Israël, était en train de fuir en courant avec son mari et leur fils de trois ans dans les bras, le sept octobre, dans le kibboutz Be’eri où ils habitaient.
Be’eri, l’un des kibboutzim les plus touchés par les massacres.
Il y a des moments où l’on n’a pas le temps de réfléchir, et les décisions deviennent une question de vie ou de mort.
Yarden a compris qu’ils ne s’en sortiraient pas.
Elle a jeté l’enfant dans les bras de son mari et elle a crié : “Cours!”.
Elle s’est arrêtée. Elle a mis ses mains sur sa tête et elle s’est agenouillée.
Elle a dit sans se retourner vers ceux qui venaient derrière : “Je me rends. Prenez‐moi.”
Dans ces mots, il y avait le vrai message : “Ne prenez pas mon enfant.”
Cela me rappelle le récit d’une jeune Nord‐Coréenne à l’ONU que j’avais entendu il y a quelques années.
Elle s’était enfuie de la Corée du Nord, encore adolescente, avec sa mère.
Elles avaient passé maintes péripéties, et à un moment elles s’étaient retrouvées dans une situation où il était clair que le passeur allait la violer.
Alors la mère a dit : “S’il vous plaît, ne touchez pas à ma fille. Prenez‐moi.”
Et la mère s’était fait violer pour épargner cela à sa fille.
Yarden est depuis ce jour maintenue en otage à Gaza.
Comme la plupart des otages, on ne sait pas si elle va revenir.
Et si elle revient, ce sont les questions que l’on se pose : dans quel état ? Et dans quel état, sa relation avec son mari ?
Yarden a fait preuve du courage d’une louve, qui sait trancher pour sauver ses petits.
Elle me fait penser au geste de Tsipora la femme de Moïse qui, dans leur voyage dans le désert, attaqués soudain par Dieu lui‐mêmeayant compris qu’il fallait agir tout de suite, a saisi ses fils et les a circoncis, au vol, avec un silex. (Shemot 4.25)
Yarden, s’est coupée elle‐même, pour qu’eux puissent vivre.
Ce qu’elle a fait est héroïque, logique, et peut‐être nécessaire, pour la survie des siens, ou du moins leur sécurité.
Et pourtant. Sij’étais elle, aurais‐je pardonné mon mari de m’avoir laissée de n’être pas resté contre toute logique, et de m’avoir laissée me faire prendre seule par les gars du Hamas ?
Ce type de dilemme est un peu comme le choix de Sophie, mais dans une autre dimension : vaut‐il mieux mourir que de s’échapper, sauver l’enfant,mais laisser sa femme derrière ?
Je me souviens d’une histoire de survivant de la Shoah, où un enfant survivant devenu adulte racontait comment ses parents avaient été pris :
Lorsque la Gestapo était entrée dans leur appartement parisien, ils avaient essayé de s’enfuir par la fenêtre, sur les toits gris de Paris, pour se mettre à la cache.
Le mari était passé avec aisance. La femme n’y parvenait pas. Il était revenu pour ne pas la laisser toute seule. Il est mort avec elle.
Ce sont des moments où l’on n’a pas le temps de penser.
Dans le cas de Yarden et de son mari, au‐delà des décisions et de leur sens, le fait est qu’elle est restée en arrière et s’est sacrifiée pour eux.
Ce type de choix au pluriel, le sien à elle, le sien à lui, laisse des traces.
L’empreinte que vont laisser, pour chacun, et au cœur de leur relation, les choix que chacun ont pris, ce matin là.
Parfois, même quand il n’y a personne à blâmer, le décalage dans les souffrances rend la reprise d’une relation difficile.
L’injustice qui a frappé l’un et pas l’autre, le sacrifice fait à un moment par l’un au profit de l’autre, la disparité entre les expériences vécues, la rancœur inavouable mais inévitable de la victime, la culpabilité insoutenable du survivant avec laquelle il faut bien vivre, tout cela devient parfois trop lourd à porter pour avancer ensemble dans le futur.
Sauront‐ils, si elle revient, se remettre de ce moment aussi potentiellement funeste pour leur couple que salvateur pour leur vie ?
Et puis le petit, les petits…
Comment vont‐ils gérer le post‐trauma ? Quels symptômes vont apparaître ?
Vont‐ils un jour pouvoir avoir un rapport normal à la vie ?
C’est un mystère dont nous ignorons encore bien des dimensions. Et peut-être,malheureusement, un cas d’école nouveau pour les psychologues de l’enfance : le post‐trauma d’enfants détenus en otage, cachés plus d’un mois en pays ennemi, à quelques kilomètres de chez eux.
Les questions abondent dans ma tête :
Ont‐ils seulement vu la lumière du jour ?
Que faisaient‐ils de leurs journées ?
Comment les traitait‐on ?
Ont‐ils gardé les mêmes vêtements pendant six semaines ?
Étaient‐ils ensemble ou séparés ?
Ont‐ils été maltraités, y compris par des enfants palestiniens, comme on le voit dans cette vidéo à Gaza le 8 octobre, ce petit garçon presque blond d’environ cinq ans, debout, la tête baissée, immobile, encerclé de petits garçons gazaouis hilares de son âge qui le bousculent à tour de rôle et lui donnent des coups en le traitant de “sale Juif”?
S’il y a eu, dans l’histoire d’Israël, des précédents d’otages, c’étaient toujours de jeunes hommes, des soldats en service qui, quelque part, connaissaient du moins en principe le risque pris. Et puis, des adultes. Mais les enfants, qu’ont-ils compris de ce qui leur est arrivé ? Et comment vont‐ils l’intégrer pour le reste de leur vie?Il n’y a plus qu’à prier pour une vraie résilience.
Le retour
26 novembre, dimanche matin avant l’aube.
Ce matin je me suis levée un peu avant 4 heures.
Ce n’était pas vraiment un choix. On avait été réveillés par un vent fort qui faisait tanguer les vieilles fenêtres mal enchâssées de notre appartement, dont le bois effrité laisse filtrer un vent qui s’engouffre par bourrasques.
C’est aussi cela, Israël : la violence des contrastes. Un ciel bleu, immuable, implacable, durant des mois, et soudain, la violence du vent et de la pluie qui font tomber le ciel sur la tête comme dans un grand mouvement de colère.
Des bourrasques ont fait claquer violemment la porte des toilettes, puis du bureau de Matan. Quelque chose est tombé dans la salon. Je me suis levée une fois, deux, je ne me rendormais pas, j’ai fini par me lever dans la nuit d’avant l’aube, l’un de mes moments préférés. De toutes façons, j’avais mis le réveil pour 4 heures et demie, en espérant pouvoir me lever pour écrire.
Merci le vent.
Je me suis levée dans la nuit étoilée un peu plus pâle que d’ordinaire, car une lune presque pleine régnait de toute sa lumière dans le ciel silencieux de Tel Aviv.
Elle baignait le salon à travers la grande baie vitrée et, quand elle a disparu derrière les immeubles en face de chez nous, prête à se coucher vers l’horizon, la pièce plongée dans le noir a retrouvé la lumière plus chaude qui l’habite depuis un mois et demi sans trève : la bougie du souvenir qui brûle jour et nuit en silence.
Quand j’éteins les lumières le soir, quand j’entre dans la pièce noire avant l’aube, elle luit calmement de sa lumière chaude, elle parle dans l’éloquence de son silence : elle me rappelle les morts pour qui elle brille, elle nous rappelle à la fois la fragilité de l’âme, et celle du souvenir .
Cette nuit‐là avant l’aube, la lune s’étant cachée, la bougie est devenue à nouveau le seul élément vivant dans l’obscurité de la pièce, troublant à peine de son mouvement vacillant le silence absolu du ciel.
Pourtant ce ciel avait fait du bruit tout le week‐end.
C’est sûrement parce qu’on a libéré les premiers otages.

Sous les regards
Ils les ont libérés après la nuit tombée, le soir de shabbat. Alors pour ceux qui comme nous éteignent les appareils électroniques lorsque le soleil se couche le vendredi soir, nous n’avons rien vu, rien entendu.
Nous avons simplement entendu le ciel, sans trêve, des hélicoptères qui passent au‐dessus de nos têtes. Car si j’ai bien compris, libérés en Égypte, ils sont immédiatement transportés en hélicoptère à l’hôpital Ichilov dans le nord de Tel Aviv, non loin de chez nous à vol d’oiseau.
Pournous les shomrei shabbat (ceux qui gardent le shabbat) nous savions que nous ne ferions pas partie de l’effervescence collective dans les foyers de téléspectateurs, témoins du premier épisode heureux depuis cinq semaines de cette nouvelle série, la guerre en vrai, une série que le monde entier vit en direct avec nous. Aujourd’hui, l’épisode de la première libération d’un groupe d’otages.
Nous n’avons pas pu assister à l’événement en direct. Et quelque part, je préfère.
Je sens dans cette excitation des spectateurs comme nous, qui voulions “voir” les extraits du processus avec le personnel accompagnant, les scènes émouvantes de réunion des familles, quelque chose de malsain.
Pourquoi avons‐nous besoin de voir ?
Nous, nous continuions nos vies, pendant que les parents dont les enfants ont été là‐bas 48 jours, les maris dont les femmes, les pères dont les enfants, souvent petits, étaient là‐bas, se retrouvaient paralysés d’angoisse nuit et jour, ne pouvant continuer leur vie.
Qui sommes‐nous pour avoir besoin de voir ces scènes de réunion familiales ?
Encore une fois, le sensationnalisme, le voyeurisme, l’addiction à l’émotionnalisme facile, viennent s’immiscer un peu trop dans une histoire qui devrait nous inviter, tous, en tant qu’humanité, à grandir.
Dans La chute de l’homme public, Richard Sennett nous mettait en garde contre les “tyrannies de l’intimité”.
Il me semble que notre société, celle du “partage” dérégulé sur les réseaux sociaux de moments de vie singuliers qui devraient être intimes, fait de l’exhibitionnisme et de son corollaire, le voyeurisme, une nouvelle tyrannie volontaire à laquelle se soumettent avec enthousiasme ceux qui ont besoin de shots émotionnels, de gratification rapide.
C’est là bien sûr un penchant profondément humain – le besoin égotique d’être vu pour se sentir exister, le besoin de voir pour se sentir en contrôle, ou pour se délecter dans les spectacle de l’identification et du vécu par procuration ; tout cela est profondément humain.
Et pourtant il semble que le monde s’en donne à coeur joie sans le moindre soupçon d’autorégulation, sans la moindre traçe d’intention de dépasser des instincts qui ne nous honorent pas.
Au XXIe siècle, exister, c’est être vu.
Au XXIe siècle, voir, c’est croire savoir.
Le XXIe siècle est un siècle de déshabillage.
Je m’en rends compte à présent, la télé‐réalité, qui m’horrifiait à ses débuts, n’était qu’un apéritif tiède de ce que nous vivons aujourd’hui. Dans cette guerre d’un pays minuscule aux répercussions globales, dans le combat d’Israël pour continuer à exister, un combat auquel le monde entier prend part à travers un regard sans trêve, le spectateur se délecte du scandale et de la violence en direct.
Mieux que les séries hyperréalistes et ultraviolentes, la vraie guerre en live.
Une guerre hypervisible dont les moments les plus intimes – les pires, comme les meurtres et viols en direct, et les plus rédempteurs, comme cette scène de vendredi soir, que je viens de voir où l’enfant, dans le couloir de l’hôpital, court pour se jeter dans les bras de son père, sous l’oeil bienveillant d’une batterie de psys, médecins, journalistes, et de millions de spectateurs comme moi attendris après avoir été horrifiés – deviennent les pôles inversés d’un même fil de regard continu qui ne laisse pas de trêve à celui qui vit.
Le cauchemar de la société de surveillance contre laquelle Georges Orwell nous mettait en garde dans 1984, nous y sommes. À ceci près que dans la société de consommation des images, les caméras, ce sont nos yeux.
Autour de moi, shabbat, tout le monde était excité.
On n’avait pas pu “voir” la libération des otages le vendredi à cause de l’heure halakhique, on attendait samedi soir, motsei shabbat, la sortie de shabbat, pour se rattraper.
Pour savoir, a‑t‐on besoin de voir ?
Je comprends bien le besoin rituel du témoignage. C’est pour cela que nous avons des cérémonies, c’est pour cela que les stars qui reçoivent des Oscars, des Molières, montent sur scène, sous le regard des spectateurs, que la performance de la célébration a pour objet d’inspirer.
Mais l’intime de la mort, l’intime de la souffrance, l’intime des retrouvailles.
Des interactions entre des êtres qui, justement, en tant qu’objets du regard, n’ont pas choisi d’être vus, de ceux‐là on ne devrait pas être spectateurs.
Car être spectateur de quelqu’un qui n’est pas en représentation, c’est du voyeurisme.
Et puis surtout, c’est un raccourci. Ce qui compte, c’est ce qui viendra ensuite.
La mémoire
On est là, tout excités et émus, à vouloir regarder les retrouvailles, comme si cela allait régler les problèmes, comme si le malheur était fini, l’épreuve terminée.
Mais on n’est pas dupes. Personne n’est dupe – du moins je l’espère.
Le retour des otages, ce n’est qu’un nouveau début.
Le début, pour la grande majorité d’entre eux, d’une nouvelle épreuve : la réadaptation, le retour à la vie “normale.”
Et cela sera peut‐être le travail, pour nombre d’entre eux, de toute une vie.
Toute une vie dédiée maintenant à la gestion du traumatisme et à la gestion de la résilience : celle de l’individu, celle des couples et des cellules familiales détruites par l’arrachement et la souffrance. Des souffrances différentes pour chacun – la souffrance de ceux qu’on a emmenés le yeux bandés et gardés captifs 48 jours, et Dieu sait quel était leur quotidien, Dieu sait ce qu’on leur a fait, Dieu sait quel était leur état d’esprit ; et une souffrance différente pour ceux qui, restés en sécurités à la maison, le corps bien au chaud et bien nourri, sans l’ombre d’un sévice à tout instant, torturés par l’inquiétude, l’incertitude, le regret, le manque, la culpabilité du survivant.
Comment se retrouvent‐elles, ces deux souffrances ? Peuvent‐elles jamais trouver un chemin l’une vers l’autre ?
Peut‐on jamais revenir à une vie normale après cela ?
Doit‐on couper une partie de son cerveau, celle de la mémoire, qui creuse un vide quasiment infranchissable entre les revenants et ceux qui les attendaient ?
Je me souviens de ce moment dans son dernier récit autobiographique, ou Marceline Loridan‐Ivens décrivait le décalage et la distanciation inéluctable qu’elle allait vivre avec sa famille, avec sa mère surtout, à son retour des camps de concentration.
“Ils ne comprenaient pas”, dit‐elle à celui qui l’interviewe comme pour elle‐même ; ils ne pourraient jamais comprendre ce qu’on a vécu.
Alors l’expérience concentrationnaire a laissé ce fossé indélébile entre elle, revenante, et sa mère et ses frères et soeurs, ceux qui n’avaient pas été pris.
Tellement de choses en jeu qui s’entremêlent, dans les dynamiques d’une famille éclatée dont certains seulement ont été des “victimes.”
Il y a l’incompréhension ; l’ignorance, l’impossibilité de savoir ce que l’autre a vécu. La peur de demander, ou trop de questions qui dérangent.
Le léger voile de rancoeur, largement inconscient, d’une mère dont c’est la fille qui est revenue vivante, plutôt que son mari.
Le léger voile d’envie, peut‐être, d’une victime revenue, vis‐à‐vis de ceux qui n’ont pas été pris.
L’obsession des mères, puis des maris, à essayer de savoir ce qu’on avait fait à leurs filles et à leurs femmes. Les avait‐on violées, comment, combien, à quel point. Des questions qui resteraient peut‐être à jamais sans réponse, mais surtout, peut‐être sans soulagement.
Car la question ici n’est pas de savoir, mais d’intégrer.Je pense à ce mari réuni après six semaines d’absence avec sa femme et ses deux très jeunes enfants, deux ans et quatre ans.
Les voilà assis ensemble sur un lit d’hôpital, collés, souriant à l’infirmière qui tend un tube en plastique à l’enfant, ou je ne sais quel appareil de mesure ou de régulation, et je me demande si le mari, qui avait sûrement pensé mille fois ne plus jamais les revoir, se demande si on touché sa femme, comment, combien, et à quel point.
Comment va être leur intimité après cela.
Comment elle va gérer son corps, sa sexualité, le retour au travail, les questions des gens, les hiboukim (embrassades) qu’elle n’a pas demandés, les regards commiséreux, mais aussi, en tant qu’Israélienne, les relations avec les Arabes et les Musulmans dans l’avenir, où vont‐ils habiter maintenant, et puis les enfants…
Les enfants parlent
Les enfants qui ont été libérés par le Hamas cette semaine ont commencé à parler.
Ils n’avaient pas assez à manger. Ils ont eu faim pendant 50 jours, plus pour certains.
Un peu de riz, une pita par jour. Les mères qui étaient là coupaient un bout de pita et en gardaient pour le lendemain, au cas où on ne leur donne rien.
Les enfants n’ont pas eu de douche pendant cinquante jours. Ils ont gardé les mêmes vêtements, les mêmes sous‐vêtements.
On les a changés, on leur a mis de nouveaux vêtements pour la première fois, juste avant de les remettre à la Croix‐Rouge.
Pour l’instant, on a encore peu de témoignages. Et puis ce sont des enfants. Pas évident d’articuler les choses.
Un enfant de 3 ans parle de “l’homme rouge” à côté de lui. Il parle de quelqu’un couvert de sang, un mort étendu à côté lorsqu’on l’a enlevé.
Pour beaucoup, la parole peine à venir.
La voix, d’abord.
Beaucoup chuchotent. Ils n’arrivent pas à parler à voix normale, tellement on les a obligés à se taire pendant près de deux mois.
Menaces de mort ; le doigt qui glisse sur la gorge avec le regard noir, à chaque geste.
L’attente interminable à chaque fois que l’on veut aller aux toilettes.
Les déplacements les yeux bandés, les ordres qui claquent.
L’arrivée à Gaza, emmenés au milieu de la foule de civils gazaouis qui frappent les enfants israéliens en les insultant.
Puis la longue détention.
Déplacés chaque jour, pour certains. De maison en maison.
Ou au contraire des jours interminables dans les tunnels sans voir le jour.
Le sens du temps qui se perd. Une petite croyait qu’elle avait été enfermée un an.
Elle croyait aussi que son père avait été pris.
Elle ne savait pas si elle le reverrait un jour.
Les enfants à qui on donne des drogues pour les calmer, ou des tranquillisants pour cheval. Celle dont on opère le pied blessé, que l’on remet à l’envers.
Une petite a appris un seul mot en arabe en cinquante jours : “silence!”
Pas le droit de se lever, pas le droit de marcher. Encore moins, pour ceux qui étaient au niveau du sol, de regarder par la fenêtre.
En entendant le peu de choses qui ressortent de leur captivité, une nouvelle dimension émerge : la torture psychologique.
Une petite croyait que tout le monde l’avait oublié, que personne ne voulait la récupérer. C’est ce qu’on lui répétait chaque jour. “Personne ne veut de toi, ils t’ont tous oublié. Tu entends les bombes ? Ils veulent te détruire avec nous.”
À d’autres, on racontait qu’on avait rasé Israël, qu’il ne restait plus rien.
Beaucoup, dont les parents les attendaient comme des ombres sur le kikar haHatoufim, croyaient que ceux‐ci étaient morts.
Un autre petit a été enfermé seul, en isolement complet dans une pièce, pendant sept jours.
Un gamin de douze ans a été forcé à visionner les vidéos live des massacres, tortures, viols, décapitations, mutilations et brûlages perpétrés par le Hamas.
Pour certains, on les a forcé de voir la vidéo où l’on massacre leur famille.
Pour une porte‐parole de services médicaux israéliens, à leur sortie, “ils ressemblaient à des ombres.” N’osaient plus rien faire. Rien toucher. Sortir d’une pièce. Demandaient s’ils avaient le droit d’aller aux toilettes.
Ils demandent “est‐ce qu’on peut regarder par la fenêtre?”
L’intimidation et la torture psychologique ne sont pas que pour les enfants.
C’est une arme bien connue du terrorisme international du Jihad : poster des vidéos d’otages, comme celui du journaliste américain Daniel Pearl, enlevé parce que juif, et décapité après qu’un message vidéo de lui affaibli, déjà ombre de lui‐même, avait été partagé avec le monde entier. C’est la dernière image que sa femme alors enceinte, de l’autre côté de l’Océan, a pu voir de lui.
Aujourd’hui on apprend qu’une pression psychologique s’exerce autour du refus de libérer le plus jeune otage, un bébé de 9 mois, détenu avec sa mère.
Hier, un journal américain faisait était d’une vidéo, disent‐ils, choquante, dans laquelle on voit les terroristes annoncer à son père, otage depuis le 7 octobre, la mort de sa femme et de son bébé, “sous les bombes d’Israël”.
La réaction en direct du captif effondré, c’est cela qu’ils ont filmé et envoyé au monde.
Faire du monde le témoin d’une détresse si intime.
N’y aura t‑il pas de rédemption pour notre monde ?
Le rêve d’Alma
Alma veut dire “monde” en araméen.
C’est aussi le nom de la fille de ma copine Sarah, qui vit à Jérusalem.
La première semaine, quand ils ont appris ce qu’il se passait, quand on ne savait pas ce qui allait se passer, Alma, enfant unique de dix ans dans la maison, ne pouvait pas dormir toute seule.
Elle venait tous les soirs dans leur lit.
Et puis un matin, au petit déjeuner, Saraha vu arriver Alma toute contente dans la cuisine, qui lui dit : “Maman, j’ai eu le rêve le plus génial!”
– Ah oui ? c’était quoi ?
– J’ai rêvé que tous les super héros de Marvel étaient ensemble, et que j’étais leur chef.
Et qu’on avait tous les super‐pouvoirs.
– Ah oui, et qu’est-ce que vous avez fait, avec ces super‐pouvoirs?”
J’ai un peu peur de la réponse.
Et voilà ce ’Alma raconte :
“On avait tous les pouvoirs. On a recollé les têtes. On a recollé les pieds.”
Elle continue son inventaire comme une comptine enfantine. Comme si elle n’était pas en train de dire ce qu’elle était en train de dire.
“Et puis on avait un super‐pouvoir en plus : on pouvait remonter le passé.
Et on pouvait faire en sorte que les gens ont oublié ce qui leur était arrivé. Ils ne le savaient plus. Ils étaient entiers, ils étaient bien.”
J’avais craint d’entendre des fantasmes de vengeance et de destruction de la part d’une petite de dix ans. Je suis soulagée.En ce moment où on lit dans la torah les parashiot sur la vie de Yossef, les rêves qui l’emmènent au fond du gouffre et ceux qui l’en font remonter, le rêve d’Alma me rappelle le sens performatif du rêve.
Le pouvoir du rêve. La beauté du rêve. Le désir de guérison, qui guérit en lui‐même.
Dans la Talmud, on dit que le rêve est un soixantième de prophétie – c’est à dire de contact direct avec le Divin, la source de Vie.
La source de vie guérit. Alma a tissé sa résilience à partir du rêve.
Nous ne sommes pas dans le rêve d’Alma.
Nous n’avons pas le pouvoir d’effacer le passé. Il y a des membres du corps qui ne se recousent pas. Des bras arrachés qui ne repoussent pas. Des morts qui ne reviennent pas. Le traumatisme, si l’on en revient, dans quelle mesure ? Cela reste un mystère, et une question ouverte.
Une chose est sûre : “Nulle chose n’existe qui ne laisse de trace”
Les brûlures restent. Les cicatrices aussi. Les trous dans le corps, dans les généalogies, dans les maisons, dans les armoires, dans les biographies.
Chaque coup porté garde une empreinte, cicatrice sur le corps ou dans la psyché, et après il appartiendra à chacun de le fondre à sa peau, à son âme.
On ne recommence jamais à zéro. Personne ne le pourra.
Le tikkoun (la réparation), n’efface pas les traces du passé. Il prend “avec”, pour aller de l’avant.
Même pour Dieu.
Lorsque, selon la mythologie biblique, Dieu, avant l’arc en ciel, envoie un déluge sur la terre pour “recommencer l’humanité à zéro”, cela n’est pas exact.
En réalité, Dieu ne repeuple pas la terre as ex nihilo. Il recommence à partir de instances déjà existantes du vivant : un couple de tout ce qui existait, depuis Noah et sa famille, à chaque espèce animale.
Si l’on recommencera, c’est “avec”, et à partir de.
C’est aussi l’enseignement profond du Talmud (Menahot 99a, 12) quant aux tablettes de la Loi brisées à la suite de la trahison d’Israël.
On se souvient peut‐être de l’épisode du veau d’Or.
Les Israélites tout juste libérés d’Égypte, se retrouvent seuls dans le désert. Moïse, leur leader, adisparu sur la montagne recevoir les tables de la Loi – l’alliance du Divin avec Israël –, et ils ne revient pas. Pardant confiance en Dieu et en leur prophète disparu, ils décident de se faire leur propre Dieu. Quelque chose de palpable, d’immédiat, de “sûr”.
Ils construisent un veau avec l’or de leurs possessions et, alors qu’ils sont en train de le célébrer, Moïse descend de la montagne, les précieuses tables dans ses bras reçues pour le peuple, et pour lesquelles il a jeûné quarante jours.
Les voyant, dans sa colère, il casse les précieuses tablettes de l’Alliance, avant d’implorer la clémence divine pour ce peuple récalcitrant.
Confiance du divin érodée en ce peuple avec qui il venait de conclure une alliance d’amour. Mais compassion du divin, et rappel de la capacité de tikkoun.
Fastforward, Dieu pardonne, et accepte de former avec eux une nouvelle alliance.
Il faudra faire de nouvelles tablettes, et différemment, car on ne peut pas revenir en arrière. Il faudra recommencer. Mais pas comme si de rien n’était.
Dieu nous rappelle ainsi les lois de la nature : l’amnésie n’est pas une option.
Le brisé ne se recolle pas sans traces.
On ne peut pas prétendre que ce qui est arrivé n’est pas arrivé.
Si on recommence, ce ne sera pas à zéro. Ce sera “avec”, comme nous le rappelle avec la puissance laconique de l’évocation, le verset talmudique : “les tablettes, et les morceaux des tablettes brisées, reposent dans l’arche”.(traité berakhot 8 B.7).
C’est ce qui nous attend aujourd’hui :
Il faudra avancer, à partir de ce qui s’est passé.
On prend tout avec nous : les estropiés, les traumatisés, les endeuillés, les handicapés à vie, les souvenirs des morts, les disparus, les inconsolables.
On recommencera avec tout cela.
Tous ensemble. Et je l’espère, avec les Palestiniens qui voudront bien que l’on vive ensemble.
C’est l’enseignement des “tablettes et des tablettes brisées côte à côte dans l’arche”, accompagnant les bnei Israel sur leur chemin.
Prendre avec nous les brisures, c’est pouvoir grandir d’elles.
Et peut‐être, créer quelque chose de plus beau.
Car la trace peut devenir beauté.
C’est ce que nous enseigne le kintsugi, l’art japonais de la sublimation des bols brisés.
L’histoire raconte qu’un Shogun avait un bol en céramique qu’il aimait énormément. Lorsque celui‐ci se brisa, il décida, plutôt que de le jeter, de le recoller. Et puisque le recollage allait se voir, il décida de demander à un orfèvre de faire couler de l’or dans les traces des brisures.
Et le bol devint un nouvel objet.
Sublime, unique. Sublimé par les traces de la brisure réparée.
Je n’ai pas accès au rêve d’Alma.
C’est peut‐être cela, mon rêve.